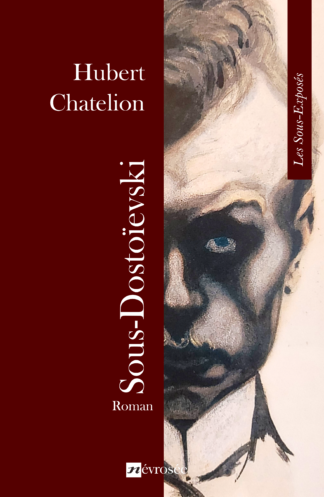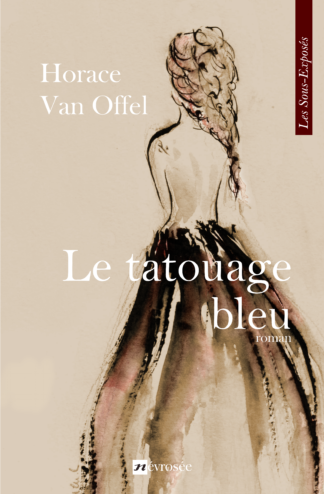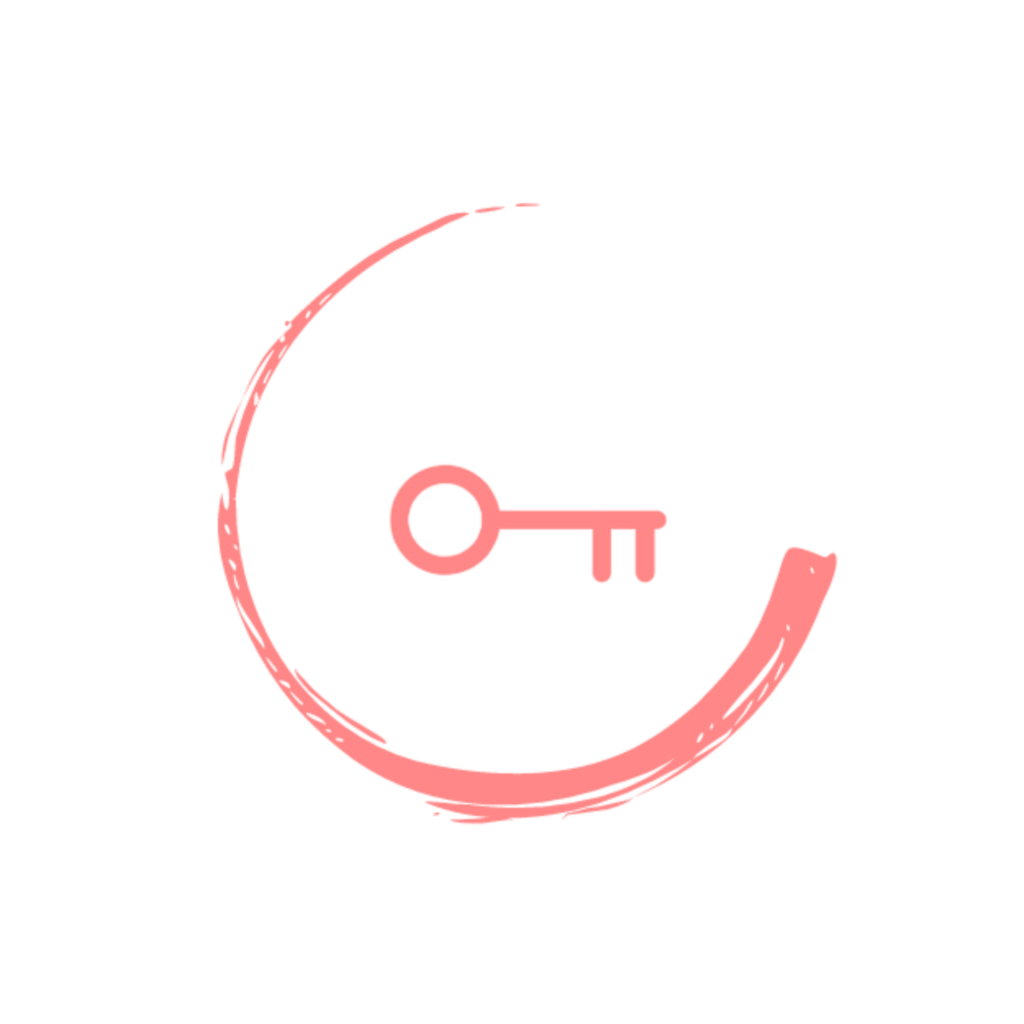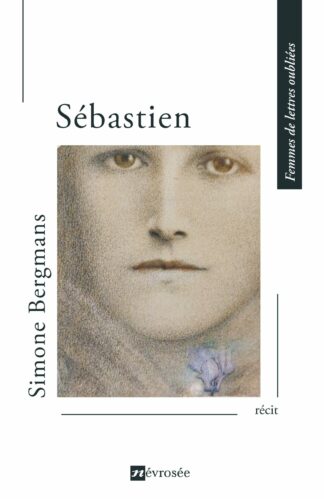Si on m’ôtait mon magasin, moi, je saute au plafond ou je deviens folle avant huit jours. Tourner toute la journée en rond dans ma cuisine ! Je voudrais les y voir, les hommes. Ils nous traitent de clapettes et de commères, parce que nous sommes toujours à causer les unes chez les autres. Ils vont à leur travail, eux, ils rencontrent des gens. S’ils restaient nez à nez toute une semaine avec des casseroles et des torchons, ils nous en diraient des nouvelles.
Nestor, mon mari, c’étaient les livres avant qu’il ne soit déprimé, surtout les policiers et les histoires de guerre. Chaque dimanche, il en rapportait toute une volée de la bibliothèque. Au point que je lui faisais reproche de vivre dans sa tour d’ivoire et de ne pas s’occuper assez des enfants. Maintenant qu’il est pris des nerfs, il passe toutes les soirées à caresser son chat, ce n’est pas mieux. Moi, je ne saurais pas me satisfaire avec des animaux ou en lisant des histoires de roman, il faut que j’aie du contact avec des vraies personnes. Et forcément, ça défile chez moi, on m’en raconte ! Un magasin, c’est quasi un confessionnal. Ce n’est pas comme les supermarchés où on donne son argent à des employées derrière leur caisse. C’est presque des automates qui vous rendent la monnaie sans un bonjour ni un au revoir.
Notez que la radio aussi, c’est précieux pour une femme. D’ailleurs, la première chose que je fais en me levant, c’est de tourner le bouton. Sans mon quart d’heure de radio et mes deux tasses de café, je commence la journée avec des pieds de plomb. Tous les speakers, je sais leur nom et les heures de leurs émissions. Ils vous parlent comme à des vieilles connaissances, à croire qu’ils sont assis à table, à boire le café avec vous. Mais parfois, je me dis que c’est une attrape. Ils ne savent rien à votre sujet, ils parlent dans le vide, sans se douter dans quelle oreille ça va tomber. Ils mourront sans avoir appris comment vous vous appelez. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui se contentent de ça, la radio ou leur poste de télé. Moi, ça ne me suffit pas. J’aime bien aussi de tenir le crachoir. On dit même que je suis une fameuse langue.
Je me suis assez morfondue à la ferme quand j’étais jeune, avec seulement les vaches et les cochons pour me faire la conversation. Et combien de fois que mes parents m’ont obligée à travailler plutôt que de m’envoyer à l’école ! Pour maman, il n’y avait que l’utile, ce qui se mange, ce qui rapporte. Elle ne voyait même pas d’un bon œil que j’aille au patronage des Sœurs, le dimanche après-midi. C’était toute ma vie, pourtant, retrouver des filles de mon âge, chanter, apprendre des danses pour les fêtes qu’on organisait, et surtout rire, dire des blagues ! À la maison, est-ce qu’on riait jamais ? Mon père avait bien trop à faire pour cultiver ses douze hectares rien qu’avec ses deux bras et son cheval, sans machines ni tracteur en ce temps-là.
Quand je rentrais de m’être amusée, c’était recta : maman m’avait préparé toute une liste de corvées pour rattraper le temps perdu. Je me souviens d’un bricolage pour la fête des mères que j’avais commencé à une réunion de patro et que j’avais rapporté à la maison pour l’achever en cachette. Maman était tombée dessus et m’avait grondée, vu que je passais mon temps à ça et qu’on n’en sortait déjà pas avec la besogne. Je n’ai pas osé lui dire que c’était son cadeau, tellement j’avais honte. Je l’ai brûlé dans la cuisinière.
Ce n’est pas que je lui en veuille encore. Pauvre femme, au point où elle en est ! Quand elle a commencé à ne plus pouvoir vivre seule, on m’a reproché de la placer dans un home plutôt que de la prendre chez moi. Mais c’était ça ou mon commerce. Il faut tout le temps être derrière elle puisqu’elle n’a plus sa tête à elle. Elle furette partout, elle sort sur la route sans crier gare. Quand elle vient passer un jour chez moi, à la belle saison, elle ne répond même plus à ce que je dis. Pourtant, on voit bien qu’elle rumine au fond d’elle-même. Quelquefois, je lui demande : « Ça ne vas pas, maman ? Tu as mal quelque part ? Tu te tracasses pour quelque chose ? ». C’est comme si je chantais Malbrough. C’est autrefois que nous aurions dû parler ensemble, au temps où elle était encore bien. « On aurait dû, on aurait dû… ». On pourrait passer sa vie à se dire ça. J’ai agi avec ma conscience, et je ne me retourne pas sur ce que racontent les gens.
Alors, moi qui aime tant voir du monde tout autour de moi, quand le petit ménage est venu s’installer en face dans la rue, aux premiers beaux jours, ça m’a fait un coup de printemps. Si jeunes ! En blues jeans, sans façon, mais des personnes d’un certain milieu, ça se voyait tout de suite. Beaux tous les deux ! Enfin, moi je les trouvais beaux, même lui avec sa barbe, ses longues jambes et son nez de travers… Et leur petite fille ! Mon Dieu, un petit bout de six mois, tellement mignonne. J’en ai été bleue tout de suite.
Il ne faut pas croire, dans le village, qu’ils aient été si bien reçus. Les réflexions allaient bon train, j’en entendais de toutes les couleurs : « Avec un bébé de cet âge-là, est-ce qu’on se lance dans des aventures pareilles ? La jeune dame est une sans allure, elle ne sait pas tenir un ménage… Avec leur culture sans engrais, ils se croient plus malins que les autres. Ils n’auront rien sur leur terrain ». C’est vrai que quand on vient de la ville, cultiver et tenir des bêtes, c’est un fameux apprentissage. Mais moi, je me mets à leur place. Chômer, toujours chômer, ça finit par vous user. Je peux en parler avec mon fils qui depuis deux ans est sans travail. Rester chez lui à se tourner les pouces, dans sa petite chambre en ville où il ne sait même pas se remuer, vous ne croiriez pas mais ça le fait maigrir au lieu de gagner des kilos. Plutôt que d’aller pointer, comme il dit, il serait prêt à vider les poubelles dans les camions ou à piocher des tranchées dans les rues avec les ouvriers du gaz. Alors, moi je pensais : « En voilà deux au moins qui tâchent de s’en sortir plutôt que de se laisser aller comme des loques ».
Mais chez nous, c’est un village de vieux. On ne s’habitue pas vite aux nouvelles figures. Les jeunes sont partis habiter en ville, ou bien quand ils ont les moyens, ils ont fait construire des maisons près des endroits où ils travaillent. Et par ici, qu’est-ce qu’ils peuvent trouver comme emploi ? Les agriculteurs n’ont même plus de quoi occuper leurs garçons depuis qu’on cultive à la machine. Les scieries font faillite, avec la crise du bâtiment et les billes en béton qu’on fabrique pour les chemins de fer. Alors, quand le jeune monsieur s’est installé ici en face, dans l’ancienne cinse Cloquet, et s’est mis à parler de ses belles théories, vendre des légumes sains et des produits meilleurs pour la santé, on riait derrière son dos. La cinse Cloquet, à ce qu’on disait, elle ne valait même pas le prix qu’ils l’avaient payée, et un de ces quatre, elle allait leur tomber sur la tête avec ses murs tout pourris. Drôle de cinse, d’ailleurs. Qu’est-ce qui reste à part les bâtiments ? Tous les champs ont été vendus, sauf un petit hectare et le verger.
Ils n’avaient pas encore de meubles et ils parlaient déjà de s’acheter des chèvres ! Car ils se sont installés avec trois fois rien, leurs livres, les tableaux qu’avait peints la dame et leur pick-up avec leurs disques. On ne vit pas de musique et d’eau fraîche. Au début, ils s’asseyaient et mangeaient sur des caisses, puisqu’en ville ils vivaient en meublé et n’avaient quasi rien emporté. Quand il leur restait le temps de manger, avec tous les travaux à faire dans la maison ! Les premiers temps, la jeune dame mettait des bouquets partout pour que ça fasse moins vide. Quel amour des fleurs ! Les premiers mètres de jardin qu’ils ont retournés, ils y ont repiqué des reines-marguerites qu’ils avaient rachetées à la vieille Mariette. Moi, je ne leur aurais pas fait payer, des jeunes qui ont tellement besoin de tout, mais par ici dans le village, c’est encore l’ancienne mentalité donnant-donnant. On se souvient encore du temps où il fallait travailler dur pour mettre deux sous de côté.
Je me rappellerai toujours leur arrivée l’an dernier, au dimanche des Rameaux. Ça m’a frappée parce qu’à cette date-là que le printemps soit déjà là ou qu’il se fasse tirer l’oreille, je rouvre le dimanche. C’est le moment où beaucoup de gens reviennent dans leur seconde résidence, car avec les problèmes de chauffage, actuellement, il y en a qu’on ne voit pas une seule fois de tout l’hiver. À l’approche de Pâques, le mouvement reprend sur les routes et il y a du passage devant chez moi.
Tout en servant une cliente, je regarde à travers ma vitrine et qu’est-ce que je vois ? Une jeune femme en jeans, très jolie par ailleurs, très fine de visage qui portait sur son dos un bébé, comme les négresses. Depuis lors, ça s’est répandu, c’est devenu une mode, mais sur le coup ça m’a quand même semblé curieux. Elle parlait avec le gros François et la grosse Maria qui habitent juste devant chez moi et passent une bonne part de leur temps, maintenant que François est pensionné, à s’asseoir sur le pas de leur porte dès qu’il y a un peu de soleil. Chacun bien enfoncé dans son fauteuil d’osier, on dirait deux gros Bouddhas. Quand la jeune femme s’est amenée, ils ont fait les yeux ronds. Avant la vente de la cinse, ils l’avaient vue passer en coup de vent avec son mari quand ils étaient venus visiter. Mais comment ils s’appelaient, d’où ils venaient, ce qu’ils avaient fait comme métier, mystère, Or, ça intrigue toujours des nouveaux voisins.
Elle avait fait six kilomètres à pied avec son bébé sur le dos. Oui, leur camionnette était tombée en panne dans la campagne. Pour le jour qu’ils arrivaient, il leur fallait bien ça. Et elle venait demander où elle pourrait trouver un garage. C’est que dans le village proprement dit, il n’y a même plus une pompe à essence. Elles sont toutes installées le long des grands routes, aujourd’hui. On lui a donc renseigné la station Esso qui se trouve à vingt bonnes minutes, et elle est repartie avec son bébé.
Pauvre chou ! J’aurais dû proposer qu’il reste chez moi en attendant. Mais je devais tenir le magasin, et Nestor, depuis qu’il est malade des nerfs, ne supporte plus les pleurs de bébé. Et puis, c’était encore une étrangère pour moi. Et nous autres, au village, on se méfie un peu des étrangers… Ça remonte au temps de notre enfance, alors qu’il y avait les premiers hôtels et les premiers touristes qui nous faisaient rire avec leur chemise Lacoste et leurs lunettes noires. En plus qu’ils passaient devant vous sans dire bonjour, et pour qu’on ne salue pas quelqu’un, au village, il faudrait qu’il vous ait tué père et mère ou qu’il ait mis le feu à votre maison.
Et les secondes résidences, ça n’a pas arrangé les choses. Car c’est devenu une véritable maladie depuis quinze ou vingt ans. Ils ont racheté dans le pays tout ce qui était à vendre pour y faire des transformations. Ils mettent des millions là-dedans, avec des pelouses, des piscines, et ils font ce qu’il faut pour qu’on voie que ça a coûté cher. Tout leur est dû, ils se prennent pour des Crésus. Il ne faut pas généraliser, il y en a qui viennent acheter chez moi et qui sont la correction même. En revanche, beaucoup sont plutôt des sans-gêne, surtout parmi les jeunes. Ils roulent comme des fous en voiture ou sur leur motorette. Ils n’ont aucune patience avec les vaches quand il y en a sur les routes, et ils klaxonnent pour leur faire peur. Ils ne savent pas ce que c’est de rentrer dix ou douze bêtes de la pâture avec tout le trafic qu’il y a aujourd’hui.
Si ce n’était que ça… Mais ils ne respectent pas les cultures. Ils passent à travers les prés qui ne sont pas fauchés, ils courent dans les blés, quand ils ne s’y couchent pas tout bonnement, avec les manières d’aujourd’hui. Car j’aime autant vous dire que pour la tenue chez la plupart ça laisse à désirer. Les filles et même les dames, en été, ça ne les gêne pas de se promener à moitié nues. Je ne dis pas que toutes les filles de par ici sont des modèles de vertu, mais devant tout le monde au moins, il y a des choses qu’elles ne se permettent pas. Et puis le week-end, il y en a qui exagèrent. On se reçoit chez l’un, chez l’autre, jusqu’à des deux ou trois heures du matin. On fait marcher les pick-ups comme si c’était la foire, on s’égosille à se crier trois ou quatre fois des au revoir, on démarre avec les voitures… Nous, pendant les week-ends, on n’a pas qu’à s’amuser. On a besoin de son sommeil.
Bref, personne n’a proposé à la petite dame de dépanner sa camionnette, et elle est repartie avec le bébé. À la station Esso, ils n’ont pas voulu se déranger. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas de personnel disponible un dimanche. Finalement, on a dû appeler Touring Secours qui lui aussi était débordé. Ça faisait bien dix heures du soir quand ils ont réparé la camionnette et que nous les avons vus débarquer, le jeune monsieur le visage tout creusé de fatigue et de faim, la maman les cheveux dans les yeux, les jambes grises de poussière, avec la tête du bébé qui lui ballottait dans le dos comme celle d’un petit lapin hors d’une carnassière de chasseur. Nous étions tous derrière nos rideaux à les observer. Et de penser qu’ils allaient coucher dans cette maison glacée, qui n’avait plus été chauffée depuis bien un an et demi, ça me donnait froid dans le dos.
Ils se sont donc installés dans la cinse Cloquet, entre chez François et Maria et la maison de Clovis, mon beau-frère. Et ça déjà, ce n’était pas de bon augure, car François et Clovis, depuis belle lurette, c’est comme chien et chat. J’ai pensé : « Aïe ! Ils ont mis le doigt entre l’arbre et l’écorce ». Je n’aime pas dire du mal de Clovis : pendant vingt ans, il a quand même été le mari de ma sœur Hortense, et il ne l’a pas rendue malheureuse. Mais être le voisin d’un numéro comme lui, je ne souhaiterais ça à personne. À la mort d’Hortense, qu’est-ce qu’il s’est imaginé ? Qu’on le regardait de travers ? Qu’on le soupçonnait de quelque chose ? Il avait oublié de remettre le couvercle sur la citerne, ça peut arriver à tout le monde. Des nuits et des nuits, en pensant à la fin qu’a eue ma pauvre sœur, j’ai été empêchée de dormir. Mais je suppose que lui, le mari, ça le turlupine encore plus que moi.
Au début qu’il était veuf, je me suis dit : « C’est le mari d’Hortense, il faut que je fasse quelque chose… ». J’ai voulu m’occuper de son linge. Je lui ai proposé de venir manger chez moi quand il voulait, même sans prévenir. Croyez-vous qu’il m’a répondu ? Depuis lors, on se dit bonjour, mais c’est tout. Pour parler, on ne se parle plus. Chaque semaine, il glisse sous ma porte la liste des marchandises qu’il lui faut. Je dépose la caisse à l’entrée de sa remise avec son compte et je trouve dans ma boîte aux lettres une enveloppe avec l’argent. C’est comme ça depuis dix ans. Parfois, je m’en fais mal à cause d’Hortense. J’ai l’impression que de l’autre côté, elle voit son mari négligé, avec ses vieux vêtements tout usés, tout rapiécés, elle qui était tailleuse de métier, et qu’elle me fait des reproches. Mais l’habitude, on dit que c’est une seconde nature.
Et la bisbrouille entre Clovis et le gros François, ça, c’est une affaire encore beaucoup pire qu’entre Clovis et moi. Je me souviens même très bien comment ça a commencé, par l’histoire de l’échelle, aussi bête que ça. Pour cueillir ses prunes dans son grand prunier, François a emprunté à Clovis une échelle, parce qu’il n’en avait pas d’assez longue. Un échelon a craqué, vu la corpulence de François qui n’a jamais été un poids plume. Il a réparé l’échelon comme il se doit, mais il l’a peint en rouge avec un fond de couleur qui lui restait, alors que le reste était vert. Ça n’a pas plu à Clovis qui est méticuleux pour ses affaires. Il faut qu’on les lui rende exactement dans l’état qu’il les a prêtées. Alors François, mordant sur sa chique, a repeint toute l’échelle en rouge, et pour éviter les explications, il l’a rapportée à la nuit, la rangeant au pied du mur. Mais aussi vite l’échelle lui est revenue, parce que le rouge, ce n’était pas du goût de Clovis. Et pendant plusieurs nuits, l’échelle a ainsi fait la navette d’un mur à l’autre. Mais ce qui a causé la rupture définitive, c’est l’histoire de la parcelle. La veuve Ligot avait un pré d’une vingtaine d’ares qui touchait à la fois au morceau de François et à celui de Clovis, un ancien terrain de la cinse Cloquet au temps de sa splendeur. François qui n’a pas assez de terre à son goût l’aurait bien voulu pour ses lapins. Mais Clovis lui a coupé l’herbe sous le pied, c’est le cas de le dire. Et ça, je crois bien que c’est par pure vengeance, car il n’en a jamais rien fait. Il l’a laissé tourner à rien. Mais il ne lui plaisait pas que François ait regard sur lui, il préférait encore laisser pousser les ronces entre eux. Et après ça, on s’étonnera que les gouvernements des pays ne s’entendent pas et cherchent des occasions pour se faire la guerre.
Quant à M. Alain, je vais dire M. Alain puisque c’est comme ça que je l’appelle, j’ai plus vite fait connaissance avec lui qu’avec sa petite dame, car c’est lui qui venait le plus souvent acheter au magasin. Il parle plus facilement qu’elle, il est plus simple, plus bon enfant. Malgré sa barbe et qu’il me dépasse d’une tête et demi, il a gardé quelque chose de gamin. J’aimais bien tailler une bavette avec lui, car avec mes deux hommes, mon mari et mon fils, je n’ai pas été gâtée, ils sont aussi taiseux l’un que l’autre. Quand Robert revient un dimanche, je ne peux pas m’empêcher de le questionner comme fait une maman, qu’est-ce qu’il fait de ses journées, s’il en sort pour ses petites lessives, ce qu’il cuisine pour son manger… Nestor, on dirait que ça lui est égal tout ça. Alors, quand je pose trop de questions à leur goût, ils se mettent à faire une partie de cartes ensemble pour que je les laisse tranquilles.
Alors, mon petit nouveau monsieur, puisqu’il voulait bien me faire ses confidences, je le laissais parler, et même des fois je poussais un peu à la charrette. Voilà deux ans qu’il était sorti de l’université avec un diplôme, philosophie, psychologie, quelque chose comme ça. Un frère à lui était parti cultiver en Australie et il lui avait pris envie de faire la même chose sans aller si loin. Ça effrayait un peu sa petite femme qui avait toujours habité en ville, mais elle comprenait que le bon air était meilleur pour leur petite.
Elle, c’était à l’École des Beaux-Arts qu’elle avait fait des études, et elle peignait des tableaux abstraits. Elle n’était pas aussi bavarde que son mari, tant s’en faut, elle me mettait moins à l’aise. Ce n’était pas vraiment de la fierté, mais elle avait une façon de vous regarder sans vous regarder, comme si vous étiez de verre. Des yeux magnifiques pourtant ! Vert pâle comme de l’eau, de l’eau qui vous file entre les doigts… Mais c’est vrai qu’elle s’habillait de façon bizarre, comme les artistes. Au premier abord, ça écarte un peu les gens.
Dans les débuts, elle était contente d’avoir quitté la ville pour la campagne, j’en donnerais ma tête à couper. Je voyais ça quand elle sortait de chez elle, rien qu’à la façon de s’arrêter sur le pas de sa porte et de respirer l’air du dehors… Au commencement, je me demandais : « Il y a une odeur spéciale ? Qu’est-ce qu’elle sent ainsi ? ». Mais non, elle respirait seulement le grand air, comme un parfum délicieux. Quand je pense que ma fille Monique, elle, quand elle revient passer un dimanche, elle reste enfermée et ne va même pas faire un tour de jardin, alors que toute la semaine elle s’est empoisonné les poumons avec la pollution de la ville. Elle n’apprécie pas le bienfait d’avoir été élevée au bon air de la campagne. La petite dame, qui n’avait jamais habité que dans des grosses agglomérations, elle se rattrapait bien, allez. Dès qu’il y avait un petit rayon de soleil, elle sortait éplucher ses légumes sur le banc de pierre, dans la cour, ou elle venait y manger sa tartine le matin, regardant le ciel avec les nuages qui passaient comme si elle se trouvait au cinéma.
Une que j’aurais bien voulu voir de près, c’était leur petite ! Je l’avais juste aperçue le premier jour, au dos de sa maman, avec sa si jolie figure, ses grands yeux bleus et ses cheveux tout bouclés. Mon petit-fils, le petit garçon de Monique, je n’en ai jamais profité quand il était bébé. Nestor n’aimait pas qu’il loge, vu que les pleurs, ça le réveillait. Alors, je ne l’ai jamais eu en vacances. Et c’est tout petits qu’ils doivent s’habituer aux grands-parents. Maintenant, il a déjà ses cinq ans, il est devenu trop personnel. Et il vous tient tête, et il vous répond ! Et il faut tout le temps que sa maman s’occupe de lui, il ne la lâche pas d’une semelle. Il n’aime pas de venir près de moi ni de son grand-père. Nestor lui fait aussi trop de remarques : « Un grand garçon comme toi ! Tu ne deviendras jamais un homme… Ta maman, quand elle était petite, elle était plus sage que toi ! » Il faut comprendre que ce gamin-là, il n’a plus de papa depuis que ses parents sont séparés. Ça marque un enfant, des choses pareilles.
J’espérais que la jeune dame viendrait un jour avec la petite au magasin ou qu’elle se promènerait dans la rue, et que je pourrais lui faire un petit bisou. Mais pour moi, ils n’avaient même pas de poussette ni de voiture d’enfant. Alors, un matin, je me suis décidée. Je me suis dit : « Je vais leur demander si je ne peux rien faire pour eux. Ce sont des choses normales entre voisins ». Je m’apprête à traverser la rue et qu’est-ce que je vois ? Maria qui entrait dans la maison. J’ai pensé : « Celle-là, il faut toujours qu’elle soit la première partout ».
Bon, je suis restée chez moi. Je n’ai pas voulu marcher sur les brisées de Maria. Surtout qu’elle allait bien trois fois par jour porter des choses au petit ménage, sous prétexte qu’ils n’étaient pas meublés, un lit de fer tout rouillé, une vieille table, des chaises qu’avec son poids elle n’aurait pas osé s’asseoir dessus. Même des affreuses postures de Notre-Dame de Lourdes et de saint Antoine, et des images du temps passé avec des couleurs presque effacées. Moi, ça m’aurait gênée de me faire ainsi quitte sur les autres de mes fonds de grenier.
Ça a toujours été pareil avec Maria. Quand on jouait des pièces au cercle Saint-Julien, c’est assez dire qu’il lui fallait avoir les premiers rôles. Ce n’est pas qu’elle soit mauvaise actrice, au contraire, c’est son affaire de monter sur une scène de théâtre. Elle aurait dû être maïeur à la place de François et faire les discours aux fêtes, car elle aime bien jeter de la poudre aux yeux. Et elle a toujours tâché de fréquenter les gens plus haut qu’elle. À l’école déjà, si une fille de notaire ou de docteur l’invitait pour jouer, il fallait que tout le monde soit au courant. Dans le village, les langues allaient bon train sur M. Alain et sur sa petite dame, mais c’étaient quand même des vedettes. Maria voulait être la première à fourrer son nez chez eux.
Le brave François s’était aussi mis à aller chez M. Alain pour l’aider avec son motoculteur. Il aime bien donner des conseils et faire l’important. À quoi voulez-vous qu’il s’occupe maintenant qu’avec la fusion des communes il n’est plus maïeur ? Il n’a plus que son jardin et il produit tant de légumes que ses deux surgélateurs sont toujours pleins. Et alors, ça commence entre lui et Maria. « Qu’est-ce que nous allons faire de tout ça ? » qu’elle demande. « On ne sait jamais, répond-il, s’il y avait une guerre… ». Une guerre ! Je vois d’ici le tableau si à cause d’une bombe on nous coupait l’électricité. Plus de froid dans les surgélateurs et tout se mettrait à gâter. Au début, les gens se rendraient malades à manger, puis il faudrait bien qu’ils jettent. Quelle affaire ! Je préfère ne pas y penser.
François et moi, tous les deux, nous nous sommes toujours bien arrangés. Il a toujours le mot pour rire, comme moi, il vous remonte le moral. Depuis qu’il a arrêté de fumer, il faut toujours qu’il suce des caramels et des petits anis. Quand il vient au magasin, il prend son sachet et il dit : « Ne le marque pas sur le compte, Nelly, fais-le rentrer dans les autres produits… ». Parce que Maria ne veut pas qu’il achète tout ça, elle trouve que ça le fait trop grossir. Si je viens de faire du café, il en boit une tasse. « Personne n’en fait de l’aussi bon que toi » qu’il me dit. Ou bien il s’assied sur l’escabeau et je le laisse lire « Les Sports » d’un client qui l’a commandé. Maria juge que c’est des dépenses inutiles. Mais elle, quand elle a des envies, elle n’y regarde pas, même si c’est du raisin en primeur à cent francs le demi-kilo.
Tout bien pesé, c’est quand même heureux que le petit ménage il a eu François et Maria. Car les premiers temps, on peut dire qu’ils en ont vu de toutes les couleurs. Quand il bêchait son jardin, le jeune monsieur, il s’arrêtait toutes les cinq minutes et regardait ses mains. Il faut des cals aux mains pour tenir un outil, et ce qu’il avait surtout, le pauvre, c’était des cloques. Pour la théorie, c’était un vrai savant, il avait tout appris dans les livres, mais je me demande s’il avait jamais fait pousser un radis. Un jour, il me dit : « C’est curieux voilà près d’un mois que j’ai semé mes carottes et elles ne lèvent pas ». « Ce n’est pas possible, que je lui fais, c’est que la semence était trop vieille, ou qu’elle a pourri en terre avec les pluies ». Je vais voir. Elles avaient levé, ses carottes, il restait bien une feuille tous les deux mètres. Mais tout le reste, les limaces en avaient fait leurs choux gras. « Comment, me dit-il, les limaces mangent les carottes ? » Évidemment, c’est des choses qu’on n’explique pas dans les livres de philosophie. Et depuis le temps qu’on leur fichait la paix, les limaces, elles se payaient une pinte de bon sang.
M. Alain, il vit trop dans les nuages, et il croit que les autres sont comme il imagine. Son idée, c’était de faire des tournées en camionnette avec ses légumes, toutes sortes de pains qu’il aurait cuits lui-même, de la bière sans produits chimiques et son fromage de chèvre, parce que ça, c’était sa principale idée fixe. Mais les gens ont leur boulanger, leur bière qu’ils boivent depuis toujours. Et puis, il y a des personnes comme ça, on les dirait abonnées aux catastrophes. Quand M. Alain s’amène avec sa longue figure, je me dis : « Ça y est, qu’est-ce qui lui est encore arrivé ? ». Les rates, les mulots, les taupes, les guêpes… Les ennuis lui courent après comme les mouches après une vache en été. C’est comme mon fils Robert. Pourquoi ne réussit-il pas mieux dans son travail ? Bien de sa personne, sérieux, travailleur. Et il perd ses emplois au bout de six mois. L’usine fait faillite, ou il a sa crise de conjonctivite… Et avec les filles c’est pareil. Tout craque au moment où on le croyait bien engagé. M. Alain, si je l’ai pris en affection c’est peut-être parce qu’il me faisait penser à Robert.
Mais que faire pour les aider ? Le matin, en mettant la chambre en ordre, puisque de là-haut je plonge tout droit dans leur cinse, je voyais la petite dame en blues jeans qui balayait la cour, nettoyait l’étable et le poulailler. Vivre à la campagne, ce n’est pas seulement venir manger sa tartine au soleil et plonger son nez dans des gros bouquets. Elle me semblait parfois si fatiguée avec ses yeux tout cernés ! C’est moi qui ai prévenu M. Alain, preuve que je ne tenais pas plus pour lui que pour elle, ainsi que Maria l’a raconté plus tard. Je lui demandais, mine de rien : « Et votre petite femme, M. Alain, ça lui plaît, sa nouvelle vie ? Ça ne la fatigue pas trop, elle qui n’est pas habituée ? ». « Ben, qu’il faisait, elle a un petit peu mal au dos… ». Mais ça n’avait pas l’air de le tracasser plus que ça. Sur certaines choses, il avait de drôles de théories. Les gens se fatiguent pour rien, disait-il, parce qu’ils contractent leur muscles en travaillant. Il faut être bien détendu, alors ça va tout seul. « Cause toujours » que je pensais, mais je plaignais sa petite femme s’il n’avait que ces discours-là pour soigner ses maux de dos. Quand je me lève à six heures du matin et que je me couche passé minuit, je n’ai pas le temps de faire attention à la façon dont je tiens mes muscles. Si mon mari m’avait prêché ça, je crois bien que je l’aurais envoyé promener.
À peine installé de deux mois, qu’est-ce qu’il trouve encore moyen d’inventer, M. Alain ? De se faire une entorse. Et sur le terrain de Clovis, encore bien. Vous me demanderez ce qu’il allait faire chez mon sauvage de beau-frère ? Ça, c’est encore une autre affaire.
Car mon Clovis, depuis que François et Maria fréquentaient le jeune ménage, il se terrait chez lui comme une bête des bois. Plus il voit que les gens vont les uns chez les autres, plus on dirait qu’il se renferme sur lui-même. Un mariage, par exemple, ou une communion dans la rue, ça le fait s’enterrer pour huit jours dans sa maison. Et moi qui ai si facile de parler aux gens, quand j’approche de lui j’ai une boule dans la gorge. Ça dure depuis que je suis toute petite. Une pareille pièce d’homme ! À quatorze ans, vous lui en auriez donné dix-huit, il faisait craquer tous ses costumes. Quand ma sœur a commencé de sortir avec lui, je lui ai dit : « Mieux vaut pour toi que pour moi… ». Rien que de lui donner le bras, j’aurais attrapé la jaunisse. La vieille sœur Émilie qui l’a eu à l’école raconte qu’il est toujours resté à part des autres. Au lieu de jouer à la récréation, il ramassait des petits cailloux et des morceaux de bois et il construisait des « usines » comme il disait, dans un coin de la cour où personne ne pouvait aller. C’était déjà le démon de la mécanique qui le travaillait.
C’est bien simple, je l’ai toujours connu un tournevis à la main. Une nuit, j’ai rêvé qu’il démontait Hortense pièce par pièce, morceau par morceau et qu’il la rangeait dans des boîtes. Et quand je le rencontre et qu’il me regarde derrière ses sourcils gros comme des buissons, j’ai l’impression qu’il va faire la même chose avec moi. Du temps que ma sœur vivait, il était plombier de son métier, mais après sa mort il a tout laissé aller. Les hommes comme ça, je me demande comment ils font quand ils deviennent veufs. On ne couche quand même pas avec sa boîte à outils, et sur ce chapitre-là, il était incroyable d’après Hortense. Ça la fatiguait plus que tout son ménage et ses nettoyages à la fois.
Le terrain de Clovis, c’est territoire interdit, pour les bêtes aussi bien que pour les gens. Or, je ne vous ai pas dit qu’il avait un chien, M. Alain. Je ne ferais pas de mal à une bête, mais quand même, où avait-il déniché ce phénomène ? Laid ! Moitié basset, moitié cocker. Et plus fou, ça n’existe pas. Toujours en vadrouille, courant après les poules, renversant les cages à lapins. Jouette plutôt que méchant, mais les petits enfants se mettaient à hurler rien qu’à le voir approcher d’eux.
Je comprends que les voisins leur ont fait des réclamations. Alors, ils l’ont attaché à sa niche. Mais comme il s’ennuyait au bout de sa chaîne, il aboyait, il aboyait ! Ça commençait à cinq heures du matin, dès que le premier vélo passait sur la route, et jusqu’au soir, ça n’arrêtait pas, avec quelque fois une séance supplémentaire pendant la nuit, quand il avait aperçu le diable ou des fantômes. Certains jours, je lui aurais bien jeté une boulette empoisonnée. Mais M. Alain était d’une patience avec lui ! À genoux devant sa niche, à lui parler comme à une personne, tout pareil que Nestor avec ses chats. Car mon mari a toujours mieux aimé les bêtes que les gens. Il fallait entendre M. Alain, alors que son satané animal aboyait à rendre fou tout le quartier : « C’est tout, mon gros chien-chien, viens faire câlin près de ton maî-maître… Il ne faut pas réveiller les petits enfants qui font dodo ». Vous comprenez qu’il s’en fichait, le gros chien-chien. Je croirais plutôt qu’il se sentait encouragé.
Et tous les soirs, M. Alain lui faisait faire sa promenade tellement il en avait pitié. Mais il lui prenait de telles crises, à la bête, elle donnait de tels coups sur sa laisse, après tout un jour attachée ! Des fois, elle lui échappait. Alors, on entendait crier à l’autre bout du village : « Homère, Homère ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Reviens tout de suite, Homère… ». Parce qu’encore bien il lui avait donné ce nom-là. « Ça y est, que je me disais, le chien est encore en train d’en faire des belles… ».
Et la terreur de M. Alain, c’était que l’animal aille faire un tour chez Clovis, car il y a partout des pancartes avec écrit dessus : « Pièges, poison… ». Et si vous entendez un coup de feu, de jour ou de nuit, vous pouvez être sûr que c’est un chat qui n’a pas lu les écriteaux, bien que depuis le temps, ils ont appris et n’y risquent plus le bout de leur queue. Il faut dire aussi que le terrain de Clovis, c’est le mystère des mille et une nuits. En plus de ses autres mécaniques, depuis l’an passé, il a construit une éolienne qui est un danger public. L’automne dernier, par tempête, une partie de l’hélice s’est détachée et elle est allée atterrir dans le jardin de François. Si c’était tombé sur les gens ou une maison, vous imaginez. Et sa dernière invention, c’est de fabriquer du gaz avec ses déchets de jardin pour faire sa cuisine et chauffer son eau, bien que sans vouloir dire du mal d’un de ma famille, je ne crois pas qu’il prenne souvent un bain. Et tout ce gaz qui s’accumule, d’après certains, ça pourrait bien faire exploser un jour tout le quartier. En attendant, il paraîtrait qu’il fait son électricité et son gaz lui-même, et comme je le comprends, c’est pour que plus personne ne mette les pieds chez lui, même pour relever les compteurs.
Et depuis qu’il a installé ses fameux appareils, son terrain est encore devenu plus sacro-saint qu’avant. Pour moi, il n’a pas envie qu’on les lui copie ou qu’on fasse un accroc dedans. Bref, défense d’approcher, c’est le règlement. Mais allez faire comprendre ça à un chien ! Un jour, Homère a passé par un trou du treillis, et on a entendu tirer. Depuis, vous savez ce qu’on a appris ? Clovis n’a même pas de fusil. Les coups de feu, c’est comme les pétards automatiques qu’on met à la saison des cerises pour effrayer les merles. Quand Clovis veut faire le terrible, il appuie sur un bouton sans même sortir de sa maison.
N’empêche que sans savoir, en entendant tirer, le jeune monsieur a transi pour son grand sot d’Homère. La moutarde lui est montée au nez, c’est encore comme mon fils Robert. Vous diriez des agneaux, mais quand ils se mettent en colère, ça compte double. Bref, malgré le fil barbelé, M. Alain a escaladé la clôture et il a sauté de l’autre côté. Puis, on n’a plus rien entendu.
De le savoir là, sa petite dame a été prise de panique. Elle est venue me trouver, blanche comme une feuille de papier, et moi aussi connaissant mon Clovis j’étais dans mes petits souliers. J’ai tout laissé là et prenant mon courage à deux mains, j’ai voulu savoir de quoi il retournait.
Encore heureux que la grille n’était pas fermée à clé. Nous avons fait le tour de la maison et arrivées par derrière, qu’est-ce que nous voyons ? Notre petit monsieur assis dans l’herbe, encore plus blanc que sa femme. En sautant, il s’était pris le pied dans l’appareil à fabriquer le gaz et avait même arraché un tuyau. Et lui, le grand benêt de Clovis, il ne pensait qu’à une chose : réparer son appareil pour ne pas perdre son gaz. Qu’il y ait des blessés ou des morts sur le terrain, ce n’était pas son affaire. Comme je le connais, il ne se serait pas retourné sur eux avant d’avoir remis sa mécanique en état.
Voilà qu’il nous aperçoit et qu’il se relève. J’en ai eu le chair de poule. Il a déjà une forte voix quand il parle, mais quand il se fâche, c’est pire qu’un avion qui passe le mur du son. Quand ça lui arrivait, du temps de ma sœur, je m’enfermais dans la buanderie pour ne pas l’entendre à quatre maisons de distance et je priais pour qu’il n’arrive pas malheur à Hortense. Trois étrangers d’un coup sur son territoire, alors que pour lui une souris c’est déjà trop en temps ordinaire ! Je me demandais ce qui allait nous arriver. Eh bien, vous ne devinerez jamais quoi. Il s’est mis à chanter, à chanter à pleins poumons.
Il faut savoir qu’il a une des plus belles voix du pays. Pour y croire, il faut l’avoir entendu. Jeune, il chantait à l’église. Et quand il commençait, tout le monde se retournait vers le jubé, même ceux qui savaient que c’était lui. Et quand nous jouions nos petites pièces au cercle, il chantait pendant les entractes, du sérieux et même du comique. Et puis, après la mort d’Hortense, ça a été fini. On ne l’a plus entendu. Bien qu’une fois ou deux sur l’année, il arrive qu’il se remette à chanter. Sans raison, un matin, ça part de chez lui, et ça dure parfois toute une demi-journée. C’est un événement dans le village. On se dit : « Vous avez entendu ? Y a Clovis qui chante aujourd’hui ».
Bon ! Le jeune monsieur dans l’herbe avec son entorse, la petite dame et moi sans bras ni jambes, clouées sur place comme si nous avions pris racine et Clovis qui chantait à sa manière à lui, avec ses grands yeux de veau et sans rien exprimer sur sa figure, vous voyez d’ici le tableau. Je crois qu’il a été pris de court. À vivre comme ça comme un sauvage, il n’a plus l’habitude de s’expliquer avec les gens. Il ne sait même plus comment on fait pour se mettre en colère, il n’a plus jamais l’occasion. Alors, il s’est mis à chanter. Et une fois commencé, il n’y avait pas de raison qu’il s’arrête, il aurait eu l’air encore plus bête. Alors, il a continué. Oui, mais, ça durait, ça durait. Et M. Alain qui se tordait de mal avec son entorse. Et la petite dame et moi qui n’osions pas bouger, car une voix pareille, ça vous fait drôle dans le ventre comme quand on va à balançoire. Ça fait trembler les carreaux des fenêtres quand il chante à l’intérieur.
Là-dessus, M. Alain a tâché de se remettre debout, mais il a poussé un tel « Aïe ! » que ça a fait taire Clovis. Il ne savait plus mettre son pied à terre, notre pauvre petit monsieur. Sa femme et moi, nous l’avons empoigné chacun par un bras pour qu’il puisse avancer à cloche-pied, mais vous voyez ça d’ici, avec son mètre nonante deux ! Alors, Clovis a grogné comme pour dire : « Ne vous mêlez pas de ça, laissez faire les hommes ! ». Et hop ! M. Alain était sur son dos. Et en avant ! On a repassé la grille et on est revenu à la cinse Cloquet. Dommage qu’il n’y avait pas quelqu’un sur la route pour nous filmer. On a sorti un fauteuil à l’ombre avec une chaise pour qu’il puisse mettre son pied dessus, et j’ai été téléphoner au docteur.
Je suis retournée à mon magasin. Mais Clovis, lui, est resté. Qu’est-ce qui s’est passé dans sa grosse tête ? Allez le savoir. Les gens disent en riant qu’il a eu le coup de foudre pour la petite dame. Pourquoi pas, après tout ? Une pareille nature, voilà dix ans qu’il était privé. Il est resté dans un coin de la cour sans bouger, comme s’il avait vu une apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. Avec ses grands bras qui lui pendaient le long du corps et sa bouche à moitié ouverte en dessous de sa moustache, on aurait juré qu’il allait recevoir la sainte communion. Comme à l’heure de midi il était toujours là, on a fini par l’inviter à manger, et il n’a pas dit non. Seulement, il n’a pas voulu se mettre à table. Il a pris son assiette et est allé s’asseoir sur une brouette dans la cour. Alors qu’à la mort de ma sœur, je lui ai proposé combien de fois de prendre ses repas chez nous ! Enfin, je ne pensais pas à être jalouse. Je me disais : « Tant mieux pour lui ! ».
Croyez que je mens si vous voulez, mais il est resté à la cinse toute la journée. Et comme on avait mis la petite dormir à l’ombre après sa panade, il est allé se pencher dessus pour la voir de plus près. Vous imaginez qu’elle a eu peur, la gamine ? Pas du tout, elle lui a fait des risettes. Je dois dire qu’une enfant pareille, j’en ai rarement vu. Facile, toujours contente ! Si un jour je reste veuve, ne parlons pas de malheur, et que je dois habiter en ville, j’ai déjà mon idée : je garderai les enfants des mamans qui vont travailler. Vous croyez que ça me gênerait d’en avoir cinq ou six à la fois ? Que du contraire. Je sais bien que les jeunes ménages, ils disent maintenant : « Est-ce qu’on doit encore en avoir avec toutes les calamités qu’on nous promet ? ». Moi je dis oui, rien que pour les montrer à ceux qui veulent déclarer la guerre. Devant un petit enfant, vous oseriez bien jeter le monde dans une pareille catastrophe, vous ?
Toujours est-il que Clovis a joué avec la petite Géraldine, lui qui n’a pas pu en avoir, et ça a été un des gros chagrins d’Hortense. Puis il a fait le tour de la cour en passant l’inspection de tout ce qu’il y avait à réparer, et ce n’est pas ça qui manquait dans une maison qui a été tellement négligée. Et tout d’un coup, sans qu’il ait rien demandé à personne, on s’est aperçu qu’il s’attaquait à la pompe à purin. Ça lui a pris tout l’après-midi. Et quand il a eu fini, il l’a fait marcher pour essayer. Et ça empestait avec les premières chaleurs, mais on n’osait rien lui dire. Avec tout ce qu’on racontait sur lui ! Taillé comme il est, avec ses cheveux jusque dans le cou et ses vieux vêtements qui datent d’au moins dix ans, car depuis la mort d’Hortense, je me demande s’il s’est seulement acheté du neuf.
Et le lendemain à six heures du matin, qu’est-ce qu’on a vu ? Clovis qui fauchait les ronces dans le fond du terrain. Et il a balancé tout ça par-dessus la clôture pour mettre dans son appareil à fabriquer le gaz. Et les jours suivants, il a achevé de faucher les ronces et les orties, sans rien demander à personne. Puis, il a continué les réparations dans tous les coins du bâtiment, portes, volets, briques qu’il remaçonnait dans le mur. On le voyait au travail, puis tout d’un coup envolé ! Des fois, il restait à manger, mais toujours dans un coin avec son assiette.
Deux qui ne se montraient plus, c’étaient François et Maria. Qu’ils mettent les pieds à la cinse alors que Clovis y était, il ne fallait pas y compter. Ils auraient eu bien trop peur d’attraper le choléra. Et ça, je trouve que c’est un peu mesquin. Rien que pour le plaisir de voir la petite, moi, j’aurais marché sur ma fierté. Il est vrai que Clovis est un peu canaille… Pour ce qui est de parler, il ne disait pas un mot de trop. Mais presque tous les jours, vive la joie ! Il se mettait à chanter. Tous les airs d’opéra l’un dans l’autre avec ceux qu’il avait retenus de l’église, « Carmen » et « Plaisir d’amour » après le « Tantum ergo ». C’était surtout quand il arrivait à la petite de pleurer. Clovis y allait de son petit concert et finis les pleurs, comme par enchantement. Ça ne m’étonnerait pas non plus, mine de rien, qu’il faisait le coq devant la petite dame. Quand elle avait mis sa lessive au fil, par exemple, ça lui donnait de l’inspiration. Tout de suite, c’était « Mexico » ou « L’auberge du cheval blanc ». Ou bien si elle épluchait ses légumes dans la cour. Mais qu’elle rentre dans la maison, puisqu’elle ne l’écoutait plus, il n’achevait pas le concert.
Mais j’ai aussi idée qu’il chantait pour faire la nique aux deux autres. C’est que c’est un fameux clairon, mon beau-frère. Comme dans la Marseillaise : « Aux armes, citoyens ! ». II vit au fond de sa tranchée, puis un beau jour, c’est la grande offensive. Il fait sauter ses pétards ou il sonne de son clairon. Et aux premières notes, si François et Maria prenaient le soleil devant chez eux, ils rentraient leurs fauteuils et on ne les voyait plus.
Pour ce qui est de Clovis, je n’avais plus de souci à me faire, mais ça recommençait de nouveau avec maman. Le lundi de la Pentecôte, on me téléphone du home Saint-Boniface parce qu’elle avait encore fait une chute. Grave, que je demande ? Non, mais son mental n’était pas bon. Me voilà aux cents coups. Comme je ferme le lundi, en saison, j’étais bloquée jusqu’au lundi suivant. Laisser le magasin à Nestor ? Même pour une journée, c’est trop pour lui. Alors, j’ai demandé à Maria. Pour recevoir les gens derrière un comptoir et faire marcher sa langue, elle est toujours prête. Elle se donne du courage à puiser des bonbons dans mes bocaux. Et François est bien content d’être quitte d’elle pour une journée.
Le lendemain, je prends l’autobus et je trouve maman la figure encore tout bleue de sa chute. Elle était assise dans un corridor et regardait par la fenêtre comme à travers les barreaux d’une prison. La directrice m’a expliqué qu’elle était très difficile de ces temps-ci, qu’elle sortait dans le jardin sans prévenir, et que c’est là qu’on l’avait trouvée couchée dans le gravier. Les infirmières la grondaient, disant qu’elle était une mauvaise tête, et maman se faisait toute petite parce qu’on était fâché sur elle. Mais on sait bien qu’elle n’a plus tous ses esprits, alors qu’on la surveille ! C’est leur métier après tout. Et elles avaient toutes l’air de me faire des reproches, comme si j’étais une fille dénaturée de l’avoir placée dans une maison.
J’ai manqué pleurer dans l’autobus en retournant. Renoncer à mon magasin et reprendre maman chez moi ? Au bout de six mois, entre Nestor qui broie ses idées noires et elle toujours à surveiller, je deviendrais comme une pile électrique et ça retomberait sur les autres. Si on ne veut pas empoisonner la vie de son entourage, est-ce qu’on n’a pas le devoir de se conserver en bonne santé ? Et pourtant mon commerce, si vous saviez ! Des fois, je suis prête à l’envoyer à tous les diables. Avec Nestor qui ne cesse de me répéter : « Pour ce que ça te rapporte ! Et tout le mal que tu te donnes… ». Et les enfants disent pareil. Et le supermarché en plus !
Ça m’a donné un coup terrible. À douze kilomètres pourtant, mais avec les voitures aujourd’hui, qu’est-ce encore que douze kilomètres ? Les gens font leurs provisions pour la quinzaine. Sans compter qu’avec tout le choix qu’ils trouvent là-bas, ils deviennent de plus en plus difficiles. Mon frigo-présentoir, ça m’a coûté dix-huit mille francs, mais je ne sais plus suivre avec les produits. Toutes les nouvelles spécialités dans le frais, ça gâte au bout de huit jours et il faut les jeter. On ne se rend pas compte de ça. Et qu’est-ce qu’ils disent tout le temps à la télé, avec leurs Unions de consommateurs ? « Méfiez-vous ! Regardez bien ce qui est marqué sur les boîtes ! Ne laissez pas passer la date écrite dessus… ». À les croire, les commerçants n’ont qu’une idée en tête, voler le client.
J’ai offert un tablier à Maria parce qu’elle avait tenu le magasin. Sacrée Maria ! Je m’en veux quelquefois d’être toujours à penser des choses sur elle. On a quand même passé notre jeunesse ensemble. Si vous l’aviez connue à vingt ans ! C’était un fameux numéro. On la voyait à tous les bals à dix kilomètres à la ronde, et elle rentrait aux petites heures avec les garçons, troussant sa robe de soirée sur son vélo comme elle pouvait. Et même au début de son mariage, elle entraînait François à gauche et à droite. Puis, ils ont pris du poids tous les deux et ont arrêté de danser. Puis, Maria s’est mise à avoir mal aux jambes. Je sais bien que ce n’est pas gai pour elle, mais elle devrait laisser à François plus de liberté. Elle est jalouse qu’il sorte sans elle, et lui, il aurait bien envie de temps en temps de s’en aller une journée pour assister à un match ou faire une excursion avec les pensionnés. Vivre l’un sur l’autre comme ils font, ce n’est pas sain. Et ça les mène à quoi ? Commérer avec les gens qui passent devant chez eux et s’attraper à tout bout de champ pour des queues de cerises. Plus la journée avance et qu’ils ont eu de discussions, plus leurs fauteuils sont loin l’un de l’autre quand ils s’installent devant leur porte. Et le soir, ils sont à chaque bout de leur trottoir comme les deux chandeliers d’une garniture de cheminée. François parle avec un, et Maria fait semblant de ne pas entendre. Elle parle avec un autre et fait exprès de dire tout le contraire de François. Enfin, je me tais, sinon on va encore raconter que je me mêle des affaires des autres.
Mais moi, je ne suis pas comme Nestor. Je ne sais pas vivre dans mes pensées et ne pas m’intéresser à ce qui se passe autour de moi. Je m’en faisais mal de l’entorse de M. Alain, et de tout le surcroît de besogne que ça faisait pour sa petite femme surtout que maintenant, à cause de Clovis, François et Maria ne les regardaient plus. Il est vrai que M. Alain, toujours avec son pied sur sa chaise, il avait trouvé un nouvel ange gardien. Vous savez bien qui ? La vieille sœur Émilie. Ça, la vieille sœur Émilie, il y aurait bien moyen d’écrire sur elle tout un livre. Elle et sœur Laurence, c’est vraiment deux curiosités à mettre sous un globe avec une étiquette. Quand elles ne seront plus là, le village ne sera plus ce qu’il était. Ce sera une époque du passé belle et bien enterrée.
Sœur Émilie, elle approche des nonante, et Sœur Laurence n’a pas beaucoup moins. Toutes les autres Sœurs sont mortes, depuis que leur école est devenue communale, mais ces deux-là sont restées dans leur vieille maison, et elles y vivent de leur petite pension. Il faudrait voir comme elles travaillent encore, repeignant les boiseries, réparant une chose ou l’autre pour ne pas payer des hommes de métier. Moi, je dis que le sexe fort ça n’existe pas. Il y a des hommes taillés comme des armoires à glace qui sont des véritables lavettes et des petits bouts de femme qui vous feraient marcher tout un régiment. Quand elles n’en sortent pas, les vieilles Sœurs, elles vont trouver Clovis qui ne refuse jamais d’y aller. Sœur Émilie l’a eu à l’école, comme presque tous les vieux du village. Elle leur parle encore comme à des petits gamins. Il y a en a qui font leurs Pâques rien que pour ne pas se faire gronder par elle, et pas un n’oserait lui manquer de respect. Nestor aussi, elle a été son institutrice, et elle se souvient encore qu’il était premier en composition et que c’est lui qui récitait le mieux les poésies.
Tant que M. Alain a eu son pied sur une chaise, elle est venue lui rendre visite et ils discutaient tous les deux sans se disputer bien sûr, pour le plaisir. M. Alain n’est même pas marié à l’église, à ce qu’il paraît, mais il a les idées larges, et quand c’est pour parler de grandes théories, il est toujours prêt. Et Sœur Émilie, malgré son âge, elle a encore toute sa tête, je voudrais bien être comme elle à nonante ans. Ce n’est pas comme Sœur Laurence qui flotte un peu à certains jours et croit qu’on va sur la Noël alors qu’on est déjà à Pâques. Pauvres vieilles Sœurs ! Quand elles ont deux sous de côté, elles viennent acheter chez moi des sucettes ou des caramels, comme des gosses. Il paraît que plusieurs fois on a proposé de les reprendre dans la Maison Mère en France, mais elles ne veulent pas quitter le village. Elles y sont depuis plus de cinquante ans. Si on les changeait malgré elles, je crois qu’elles dépériraient comme des plantes qu’on repique à un mauvais moment.
Bref, à recevoir des visites et à lire des livres tant qu’il voulait, M. Alain, il n’avait pas l’air de s’en faire. Mais une qui trimait pour deux, c’était sa petite femme. Je le voyais à sa figure toute tirée. À chaque fois qu’elle venait acheter chez moi, je regardais ses petites mains déjà tout abîmées. J’en vois des mains sur mon comptoir quand on paie les marchandises ! Et elles vous en racontent des choses. Mais sa fatigue à elle, ce n’était pas seulement physique. On sentait bien qu’elle n’avait pas assez de satisfaction dans la vie. Quand ses fenêtres étaient éclairées le soir, je la voyais coudre bien tard ses rideaux. Des rideaux trop beaux pour leur vieille baraque, qu’elle avait achetés Dieu sait quel prix dans les magasins. Ou bien pendant la journée, elle cessait tout d’un coup ses gros travaux pour se mettre à faire des bouquets. Alors, on sentait qu’elle était dans un autre monde. On aurait dit une petite fille qui joue après avoir fait ses devoirs.
Surtout que M. Alain, il a l’air de vivre dans les nuages, mais il a bon appétit avec son grand corps et il aime bien manger à ses heures. Et quand elle avait perdu trop de temps avec ses amusettes, il savait montrer qu’il n’était pas content. Ça, c’est les hommes. Pendant qu’ils font la sieste ou lisent leur journal après avoir mangé, les femmes lavent la vaisselle. Et je voudrais bien savoir, dans les ménages, qui est le plus souvent à regarder la télévision… À travailler comme nous faisons, c’est nous qui devrions attraper des infarctus et des maladies de cœur. Tout compte fait, on est encore de la meilleure fabrication que les hommes. À voir la petite dame qui s’affairait tellement, je disais à Nestor : « Tu n’irais pas lui donner un coup de main, toi qui aimes tant peindre et tapisser ? ». C’est vrai, il aime ça et il a du temps. Sur nos châssis de fenêtre à nous, il y aura bientôt plus de couleur que de bois. Mais pour aller chez les autres, non, il est trop renfermé. Et ça empire avec les années. Son père l’a élevé d’une manière trop brutale. Pour une bêtise, il l’envoyait au lit sans souper, et quand il avait fait pipi au lit, il le plongeait en pyjama dans le tonneau en-dessous de la gouttière. Enfin, je n’ai pas à me plaindre, il fait mes nettoyages. Il frotte et il astique mieux que moi, à condition qu’on lui laisse le temps et qu’on ne le dérange pas.
Pour l’aider dans son jardin, M. Alain, Sœur Émilie lui avait trouvé quelques gamins en vacances de l’école d’agriculture. Mais des gamins, qu’est-ce que vous voulez, c’est des gamins ! Quelquefois je les voyais se bombarder avec des poires pourries au lieu d’arracher les herbes. Ou bien ils s’arrêtaient pour allumer la cigarette, car à douze ans maintenant, ils vous ont ça au bec quand ce ne sont pas des drogues défendues. Ils riaient grossièrement, ils rentraient dans la maison avec leurs pieds sales. Et le chien faisait pareil, une bête qui avait la manie de se rouler dans les ordures et qui ramenait tout ça à l’intérieur. Et sauvage comme il était, combien de fois il a fauché les parterres de fleurs pour courir après les mouches ou ses fantômes. Car c’est un animal qui avait ses lubies. Pauvre petite dame, il lui fallait bien de la patience ! Le matin, elle ne venait même plus manger sa tartine dehors sur le banc de pierre, en regardant passer les nuages dans le ciel.
Il faut être bon dans la vie, mais pas trop. M. Alain, il est trop bon avec tout le monde. Des amis, je ne sais pas combien il en a, mais j’en ai vu défiler à la cinse Cloquet ! Ils s’amenaient à toutes les heures du jour, aussi bien la semaine que pendant le week-end. Et c’était toujours porte ouverte. Ça restait à manger, et souvent ça logeait. Il y avait de la lumière jusqu’à des deux, trois heures du matin. Ces choses-là, c’est bien quand on est garçon. Mais la femme, est-ce qu’elle est toujours d’accord ? Et ça coûte de recevoir. Et la besogne ne se fait pas. Et souvent, avec sa camionnette, il allait donner un coup de main chez l’un ou chez l’autre, ou faire un déménagement. Et quand il n’était pas rentré le soir, sa petite femme venait tout le temps à la rue pour voir s’il n’arrivait pas. Et un soir, passé neuf heures, il téléphone chez moi. Il était bloqué dans la campagne parce que, à une pompe automatique, il avait mis du mazout à la place d’essence dans son moteur. C’est l’homme à faire des choses pareilles, et des encore pires. Il voulait que j’appelle Clovis pour savoir comment s’en sortir. Mais Clovis, il ne s’explique déjà pas facilement comme ça, faut pas demander au téléphone. « Faut sucer, qu’il répétait tout le temps, faut sucer avec un tuyau ». Vous pensez, sucer tout un réservoir de mazout ! Il a tellement sucé, le malheureux, qu’il a dû en avaler un bon coup. Il est rentré malade, et le lendemain, il était encore tout vert
C’est à croire qu’il le fait exprès, au point que je l’appelle M. Catastrophe. Combien de fois il a oublié de fermer la porte de l’étable ! Rattraper les chèvres, le matin, c’était une vraie corrida. Et son four à bois qui refoulait et qui enfumait la maison ! Et son pétrin à moteur ! Parce qu’il faut cuire au bois, maintenant, avec les nouvelles théories. Il faut revenir aux anciennes méthodes pour que le pain soit bon. Et M. Alain avait idée de vendre des pains de toutes les espèces dans ses tournées. C’est Clovis qui lui construisait ses mécaniques, mais le défaut de Clovis, c’est de toujours vouloir faire du neuf avec du vieux. D’une essoreuse qui ne servait plus, il avait fait une machine à plumer les poulets. Fallait voir ça, des espèces de doigts en caoutchouc qui tournaient à toute vitesse et les plumes qui volaient ! Oui mais, ce n’est pas éternel, la mécanique, ça finit par tomber en panne, Et quand c’est le pétrin qui avait des lubies, avec trente kilos de pâte à moitié travaillée, c’était le grand branle-bas. On sonnait le rassemblement général. Tout le monde devait se mettre à pétrir à l’huile de bras, M. Alain, sa femme, les gamins qui rappliquaient du jardin et ne prenaient même pas la peine de se laver les mains. On pétrissait sur tout, la table, les appuis de fenêtre et même le banc de pierre dans la cour. Ils y allaient de bon cœur, mais question propreté, pour ce qui est moi, j’aime autant le pain du boulanger.
Et pas question que Clovis le lui répare, son pétrin, car j’ai oublié de vous dire, Clovis ne mettait plus les pieds chez eux. Encore une fois que M. Alain a voulu bien faire et que ça a tourné contre lui. Il faut savoir que Clovis a construit au bout de son terrain, dans la partie qui touche à la parcelle de François, un foyer en beems pour brûler ses crasses. D’après François, il s’en sert toujours quand il fait vent d’est, pour lui envoyer la fumée. Et c’est vrai qu’il est rare, chez nous, le vent d’est. Si Clovis choisit le jour où ça souffle de là, je ne jurerais pas que c’est un hasard. Mais ce que François ne dit pas, c’est que lui, pour brûler ses déchets, il profite du jour où il y a un bon vent d’ouest, et je vous assure qu’on ne voit même plus la maison de Clovis tellement ça fume épais.
Donc, M. Alain, puisqu’il avait la permission, brûlait ses vieux papiers dans le foyer de Clovis et il voit que François s’apprêtait à brûler ses fanes de haie. Gentil comme il est, il propose de s’en charger. Mais ne fallait-il pas que ce jour-là, le vent souffle justement de l’ouest ?
François le savait bien, roué comme il est. Il a tout balancé par-dessus la clôture. Et trempé de la dernière pluie, ça fumait comme un vrai four crématoire. Clovis a vu rouge. À l’avenir, défense de mettre les pieds sur son terrain et il s’est renfermé pendant toute une semaine. Sœur Émilie y est allée deux fois. Porte de bois… Même chose avec le « Baraquie », l’homme qui habite une roulotte dans la carrière et qui ramasse les vieux fers. En plus des deux vieilles Sœurs, il n’y avait que lui qui parvenait encore à s’arranger avec Clovis, et chaque semaine, il allait boire la goutte avec lui. Mais Clovis l’a laissé dehors, lui aussi.
Du coup, voilà François et Maria qui rappliquent chez M. Alain, mais je me demande si c’était bien l’idéal. François qui donne des conseils sur tout, et Maria, toujours à faire plus qu’il ne faut pour s’attirer des mercis… Un jeune ménage, il a besoin qu’on le laisse un peu tranquille. D’ailleurs, entre M. Alain et sa petite dame, quand est-ce que le torchon a brûlé pour la première fois ? Je le sais bien, moi. Quand la Mme Vanstrip s’en est mêlée. Vous voyez qui je veux dire, la dame qui habite la seconde résidence juste au-dessus de l’hôtel des Quatre Fils Aymon. Et son mari, c’est le monsieur toujours tiré à quatre épingles qui roule comme un fou dans le village avec sa grosse B.M.W.
On dit que l’argent n’a pas d’odeur, mais moi je trouve qu’il en a. Les gens qui ne vivent que pour l’argent, ça se sent tout de suite. Et pour un jeune petit ménage qui arrive juste à nouer les deux bouts, je le dis comme je le pense, il y a un autre monde que ça à fréquenter. Elle, c’est bien simple, je l’appelle : « Madame je suis pressée… », parce qu’au début qu’elle venait au magasin, s’il y avait deux personnes à servir avant son tour, c’était déjà trop. Elle prenait ce qu’il lui fallait dans les rayons et elle criait ; « Je suis pressée, je vous paierai demain… ». Pressée de quoi ? Elle n’est ici que pour prendre du bon temps, aux vacances et aux week-ends. Qu’est-ce que je devrais dire, moi ? Une fois, elle a passé les bornes. Sans rien demander, elle avait grimpé sur l’escabeau pour prendre un quart de café. Et voilà-t-il pas qu’elle chipote à ma moulinette électrique pour le moudre elle-même ? Alors, j’ai éclaté. Je lui ai dit : « Laissez ma moulinette tranquille, Madame. Chacun son tour comme à confesse… Nous sommes aussi pressés que vous ». Rouge, qu’elle est devenue ! Et quand son tour est arrivé, elle n’a jamais été aussi polie et comme il faut. Et par après, vous croyez qu’elle m’en a voulu ? Que du contraire. Depuis lors, elle fait même des chichis avec moi. Comme quoi la franchise avec les gens, ça paie quelquefois.
Or, elle connaissait bien la petite dame de M. Alain. C’était une ancienne amie de sa maman. Et voilà qu’elles tombent nez à nez à faire leurs commissions chez moi. Et on s’embrasse ! Et on fait des manières comme c’est l’habitude dans ces milieux-là. « Que le monde est petit ! Vous peignez toujours des tableaux ? Et vous habitez là tout près ? Il doit faire adorable chez vous… ». Du coup, la petite dame la ramène chez elle, et tout ce qu’elle a à lui montrer, ce sont les riquettes de Maria. Toute gênée, elle s’excusait comme elle pouvait : « C’est des choses qu’on m’a données… ». Alors, la grande Mme Vanstrip, elle n’y est plus allée avec des gants. Du ton qu’elle prenait pour faire ses réflexions et avec les fenêtres ouvertes on entendait tout. Et si Maria n’est pas sourde, elle a dû en prendre pour son rhume.
Fréquenter une personne pareille, pour moi ce serait une punition. J’en attraperais des boutons. Mais il faut se mettre à la place de la petite dame. Depuis qu’elle était arrivée, avec qui avait-elle eu des occasions de parler ? Avec les demi-sauvages qui venaient dire bonjour à son mari et vider un bac de bière avec lui ? Rien que pouvoir sortir de ses murs, pour elle c’était un changement. Et encore bien pour aller dans une maison qui est un vrai palais ! Mme Vanstrip venait la chercher presque tous les jours dans sa grosse voiture. On devait mieux s’y sentir que dans la vieille camionnette qui avait tout le temps des pannes.
La petite dame, ça l’arrangeait bien de faire salon. Mais pour M. Alain, c’était une autre paire de manches. Avec ses bottes et son chandail, je le vois mieux dans un jardin ou dans les bois que dans les fauteuils d’une Mme Vanstrip, en train de boire des tasses de thé. Quand elle venait en visite, il se trouvait tout d’un coup du travail à l’autre bout de son terrain. Et plus elle restait longtemps, plus il travaillait fort, comme pour passer ses nerfs sur ses outils. Et si on rabrouait son chien parce qu’il sautait sur la madame avec ses sales pattes, au lieu de le gronder, il le caressait et lui faisait des amitiés au fond du jardin. Et quand c’était sa femme qui était partie en visite, il s’installait dans un transat avec sa pipe et un livre comme pour dire : « Puisque les femmes prennent du bon temps, je ne me fatigue pas non plus ».
Notez bien qu’on a tous ses problèmes. La Mme Vanstrip, avec ses quantités de millions, elle n’est pas plus heureuse que vous et moi. En premier lieu, son mari est une amusette. Toute la semaine il reste en ville, soi-disant pour ses affaires, mais il ne s’ennuie pas à ce qu’on dit. Et pendant les week-ends, au lieu de rester en famille puisqu’il les voit si peu, il trouve encore moyen d’être la moitié du temps aux Quatre Fils Aymon pour vider sa chope et courir après la serveuse, une gamine de seize ans.
En deuxième lieu, elle a bien du souci avec sa grande bringue de garçon. Tout Vanstrip qu’il est, il n’a pas inventé la poudre. Mon fils n’était pas non plus un dégourdi, mais il travaillait bien à l’école et il a eu son diplôme. Mais lui ! Dans les études, c’est une vraie nullité. Et pour des gens qui ont de l’ambition comme eux, ça les empêcherait bien de dormir.
Et puis leur fille, ça je vous le dis franchement, c’est une vraie petite peste. Prétentieuse, ne regardant personne ! Fardée comme une star alors qu’elle n’a pas quinze ans. Disant le mot de Cambronne à sa mère plus facilement qu’au revoir et merci, et d’autres expressions que je n’oserais pas répéter. Ça, c’est l’éducation de maintenant. On peut tout dire, tout faire, s’habiller n’importe comment, même dans les bonnes familles. Et bien moi, je n’ai pas peur des mots, je trouve qu’une fille de cultivateurs comme moi était mieux comme il faut que certaines filles de ministres aujourd’hui.
Mais quand on a de l’argent, qu’est-ce que vous voulez ? On m’a dit que Monsieur est dans les affaires et qu’il prend l’avion presque tous les mois. Et ici dans le pays, mondains comme ils sont, ils connaissent presque toutes les secondes résidences. Ils achetaient beaucoup au jeune ménage, leur pain, leurs légumes, les œufs et leur fameux fromage de chèvre. Car M. Alain, il m’aurait fait rire quelquefois avec son fromage de chèvre : pour lui, c’était le meilleur délice qu’on puisse trouver sur terre. À en manger comme il faisait, je me demande comment il ne se dégoûtait pas. Et c’est quand même grâce aux relations des Vanstrip qu’il a commencé ses tournées, car les gens du village, ils ne croient pas aux théories sur la façon de manger, et ils ne donneraient pas un franc de plus pour du pain comme ci ou comme ça.
Une que j’aurais bien croquée, c’était la petite Géraldine. Mignonne ! Elle commençait à aimer les bonbons. Alors, entre deux clients, quelquefois, quand je l’entendais babiller dans son petit relax, j’allais vite lui porter quelque chose de sain et de nutritif, sans colorant. Elle me connaissait bien, allez ! Elle gigotait comme un petit diable en me voyant arriver. Les enfants, ça grandit trop vite. Je n’ai pas eu le temps de voir pousser les miens. Dans un métier comme moi, ce ne sont pas seulement les mains qui sont occupées, c’est la tête : les commandes à rentrer, les comptes, la T.V.A. En plus que moi, je ne sais pas penser à deux choses à la fois. Un jour, ma fille Monique m’a demandé quand elle était petite « Tu joues avec moi à la marchande ? ». J’ai fait comme les mamans, j’ai répondu que je n’avais pas le temps, qu’elle aille chez une petite amie. Mais je l’ai toujours regretté. Elle ne m’a plus jamais demandé de jouer avec elle. Quand elle était petite, c’était un vrai moulin à paroles, elle n’arrêtait pas. Au point que je lui disais quelquefois « Tais-toi un peu, Monique, on n’entend que toi ». Maintenant, je suis bien attrapée. Quand elle vient, je la trouve tellement silencieuse, surtout depuis qu’elle est séparée de son mari. Ou on parle de choses extérieures, et encore, ce qu’elle veut bien me dire.
Je repense souvent au temps où mes enfants étaient petits. Ils ont toujours préféré jouer chez les autres que rester chez moi. Je les laissais faire pour qu’ils ne soient pas dans mes pieds. Puis j’ai senti qu’ils se plaisaient mieux ailleurs et j’ai voulu les retenir le dimanche en faisant des gaufres l’après-midi et en leur proposant d’inviter leurs amis. Mais ça ne les intéressait plus. Ils sont sortis avec des copains et des copines. J’ai l’impression qu’ils n’ont jamais aimé leur chez eux. Quand ils reviennent, ils demandent la permission de prendre telle ou telle chose dans les armoires, et ça me fait mal. Je préférerais qu’ils soient sans gêne et se servent sans façons, comme si c’était encore leur maison. Et le petit Thierry, quand il vient, demande aussi tout de suite à retourner chez lui. Ça, j’ai idée que c’est parce que sa mère l’a mis trop tôt à l’école, alors qu’il n’avait pas encore trois ans. Mais que voulez-vous, quand une femme travaille ? De quoi vivrait-elle maintenant qu’elle n’a plus de mari ? Et puis, c’est l’ennui des commerces, il n’y a pas beaucoup de place chez moi pour se remuer. Si j’étais obligée de remettre mon magasin, j’en ferais une grande pièce où j’aurais la place pour recevoir les enfants. En attendant, je me réveille parfois la nuit et je pense tout d’un coup : « J’ai un petit-fils qui va bientôt avoir cinq ans… Est-ce que c’est vrai ou est-ce que je l’ai rêvé ? ».
Je disais toujours à la jeune dame : « Si vous devez vous en aller quelque part et que vous êtes embarrassée, mettez-moi la petite, ce serait une fête pour moi… ». Alors, un samedi, elle m’a demandé si je pouvais la prendre ce soir-là et qu’elle dorme chez moi. Les M. et Mme Vanstrip l’avaient invitée avec son mari et d’autres amis. Moi, j’aurais bien fait des bonds de joie. Et puis, un jeune ménage, je me disais que ça a besoin de sortir ensemble quelquefois, sans s’inquiéter des enfants.
J’ai vite descendu mon vieux berceau du grenier. Je l’ai bien nettoyé et j’y ai mis des jolis petits draps que j’avais encore. Je l’avais installé dans ma salle à manger pour que Nestor ne soit pas empêché de dormir si la petite se mettait à pleurer. Moi, je coucherais sur le divan à côté. Du moment que je peux étendre mes jambes, dormir sur une planche comme les carmélites, ça ne me gênerait pas. Bref, le soir, je ne savais pas fermer l’œil tellement j’étais contente. Et je me relevais quelquefois pour voir si mon petit bout ne se découvrait pas et le reluquer tout mon saoul. Et tout d’un coup, il n’était pas minuit, je m’aperçois que la cinse est éclairée. Je me dis : « Est-ce qu’il serait arrivé malheur ? Je vais quand même aller frapper ».
M. Alain vient m’ouvrir, Je lui demande s’il n’est pas malade. Au lieu de me répondre, voilà deux grosses larmes qui lui sortent des yeux. Je me suis excusée, je m’en suis retournée. Qu’est-ce qui s’était passé ? On ne quitte pas ainsi une soirée sans motif. Et toutes sortes de petites choses me sont revenues à l’esprit. Quand Mme Vanstrip venait la chercher, la petite dame, elle prenait quelquefois ses boîtes et ses pinceaux pour peindre là-bas, mais jamais chez elle, près de son mari. Pourquoi ? Il lui avait fait des remarques ? Ou ça la gênait devant lui ? Et un soir, je vais la prévenir qu’on l’appelait au téléphone. Pendant qu’elle y va, je dis à M. Alain qui était assis sur une chaise dans la cuisine : « Vous aimez bien les chaises, M. Alain, alors que vous avez un si joli petit salon dans votre maison ». C’était une pièce vide aménagée par sa dame vu qu’ils avaient de la place pour loger tout un régiment. Elle avait retapissé, mis des rideaux, acheté des fauteuils d’occasion. Mais lui, assis sur sa chaise en bois dans la cuisine, il me répond tout sec : « C’est le salon de ma femme ». Et il se remet à lire son livre. « Bon, que je pense, j’ai encore trop parlé. J’ai dit ce qu’il ne fallait pas ». Est-ce que pour lui c’étaient des frais inutiles ? J’ai déjà remarqué que dans certains domaines il est un peu près de ses sous. Avant d’installer le téléphone, par exemple, il s’est longtemps fait tirer l’oreille. Alors forcément, sa petite femme venait téléphoner chez moi à sa mère qui est en France et à sa sœur qui habite Anvers, et ça durait quelquefois. Quand il allongeait sa figure devant la note, je lui disais pour blaguer : « Les femmes sont des longues langues, n’est-ce pas M. Alain ? Quand elles parlent ensemble, on ne peut plus les arrêter… ». Mais il ne riait pas toujours.
Je crois que Maria n’a pas eu une bonne influence non plus. Elle avait mis dans la tête de la petite dame que ce genre de culture-là ça ne rimait à rien. Pour cause… Dans son jardin, tout pousse à l’engrais. Et ce qu’elle avait trop en légumes, elle voulait bien les leur donner pour qu’ils les vendent comme biologiques. La petite dame aurait encore bien été d’accord. Mais M. Alain… ! C’est l’honnêteté incarnée. Rien que l’idée le mettait hors de lui. Maria lui conseillait aussi de monter ses prix, elle qui aurait tendance à jeter l’argent par les fenêtres, qui achète chez moi toutes les nouveautés et souvent ne les achève même pas. Et la petite dame tenait avec elle. Mais lui, il est du genre idéaliste, il n’aime pas exploiter les gens. Alors, ça faisait des conflits sans fin. Et c’est aussi Maria qui lui a conseillé de faire magasin chez eux à certains jours. Avant, ils mettaient quelques marchandises en dépôt chez moi, leurs pains, leurs légumes, leur fromage. Pour ce que je gagnais dessus, vous pensez ! Je n’en fais pas un plat. Mais de la part de Maria, ce n’était pas très délicat pour moi.
Un jour, une voisine me dit : « Tu ne penses pas que Clovis a quelque chose ? ». « Pourquoi ? ». « Je ne l’ai plus vu sur la rue depuis une semaine ». C’est vrai que je vis un peu en vase clos, moi qui ne sors jamais de chez moi sauf pour la messe du dimanche. Et puis, il me fait peur, ma grande bringue de beau-frère ! Je préfère oublier qu’il habite la porte à côté. Mais aux hommes de cet âge-là, on ne sait jamais ce qui peut leur arriver avec leur cœur et leurs artères. Je vais donc frapper chez lui. Et comme on ne répondait pas, tant pis ! Je suis entrée.
Quel bazar dans cette maison ! À ne pas savoir mettre un pied devant l’autre. Il était couché dans son lit, au fond de sa petite salle à manger puisque du jour où Hortense est morte il a descendu un lit et n’est plus jamais remonté. Je lui demande ce qui ne va pas. « Je me repose, qu’il dit, je suis fatigué ». Ça me faisait drôle de le voir couché vu qu’il n’est jamais malade. « Et pour votre manger, que je lui demande, comment est-ce que vous vous arrangez ? ». « Je n’ai pas faim », qu’il me répond.
Je veux allumer son gaz pour lui faire du café. C’est à peine si j’ai une flamme comme une allumette. Son gaz qu’il fabriquait, bernique ! Ça marchait quand ça voulait bien. Il devait souvent faire avec des boîtes. Et je me disais parfois : « Il doit se coucher bien tôt ! Il a déjà éteint ses lumières ». Je ne pensais pas que son éolienne, ça lui jouait aussi des tours. À vivre sans électricité, pas étonnant qu’on finisse par broyer du noir.
Sans rien lui dire, j’ai appelé le docteur. Je croyais qu’il allait faire une scène et envoyer tout le monde promener. Pas du tout ! Il s’est laissé voir comme un petit enfant. Le docteur n’a rien trouvé, mais il m’a dit qu’à son avis, c’est le moral qui était atteint. Moi, j’ai tout de suite pensé à la dépression de Nestor et j’ai pris peur. Quand je songe qu’à l’époque où il était en bonne santé, je lui reprochais de passer trop de temps à lire ses livres et à écouter les jeux radiophoniques à Luxembourg… Si ce temps-là pouvait revenir ! Dans le journal, il ne lit plus que les catastrophes, et c’est pour découper les articles et les ranger dans des enveloppes : tremblements de terre, inondations, accidents d’avion, hold-up et je ne sais quoi…
Alors, je me suis dit : « Si ça commence avec Clovis, c’est du propre ! ». Et vous savez ce que j’ai fait ? Je suis allée chercher la vieille Sœur Émilie. Elle vaut un docteur. Elle raconte ses petites bondieuseries, qu’il faut dire telle ou telle prière, et elle fait boire une cuillerée d’eau de Lourdes. Mais vous savez que les gens l’écoutent ? Et que souvent ils sont guéris ? Elle s’est amenée et lui a dit : « Levez-vous, Clovis, vous êtes trop grand pour rester au lit toute la journée. Et mettez un peu d’ordre dans vos affaires, un chat n’y retrouverait pas ses jeunes ». Et Clovis écoutait. Il rangeait un peu son barda. Ce qu’il a eu, j’ai mon idée là-dessus. Il était attaché au petit ménage. Que François et Maria reviennent à la cinse Cloquet, ça l’a rendu jaloux. Et à le voir ainsi couché tout seul dans son grand lit, ça m’a rappelé Hortense et j’en ai eu les larmes aux yeux.
Que ma sœur soit morte comme ça à quarante-deux ans, je ne pourrai jamais m’y faire. Dieu sait que j’ai toujours aimé mon mari et mes enfants, mais Hortense, personne ne pourra la remplacer. Ce qu’on a pu se détester, pourtant, et se faire des méchancetés quand on était gamines ! Je la traitais de marmotte et d’empotée, alors que moi j’étais un garçon manqué. Je lui reprochais de me laisser tout le travail sur les bras pour jouer avec son petit ménage et ses poupées. Et puis, j’avais l’impression qu’elle n’était pas franche et qu’elle racontait à mes parents des choses sur moi.
Et puis, quand on est devenues plus grandes, on a commencé à se comprendre. Et après que je me suis mariée, je me suis rendu compte qu’il n’y avait qu’avec elle que je pouvais vraiment causer. Les clients, pour vous raconter leurs histoires, ils sont toujours prêts. Mais dès que vous commencez avec les vôtres, ils deviennent pressés. Comme amie, ce qu’on peut appeler une amie, je n’ai jamais eu que ma sœur. Et ça a duré trop peu longtemps.
Enfin, voilà notre Clovis remis sur rails et qui va de nouveau son petit train-train. Je n’y suis pas pour grand-chose, j’ai fait ce que j’ai pu. On entend comme avant ses bruits de ferraille et ses coups de marteau sur ses mécaniques. Mais pour chanter, j’ai idée que c’est fini, tant que François et Maria seront familiers avec le petit ménage.
Quand je suis tranquille d’un côté, ça commence de l’autre. Nelly par ci, Nelly par là ! Si quelque chose ne va pas quelque part, je sais bien à qui les gens vont venir s’adresser. Donc un soir de septembre, au moment que j’allais fermer, c’est M. Alain qui s’amène avec sa figure des mauvais jours. Est-ce que je n’ai pas vu sa femme ? qu’il me demande. Et il vide son sac. Le matin, elle se lève comme d’habitude. Elle soigne les bêtes, elle se met à éplucher la soupe. Et tout d’un coup, crac ! Elle jette son couteau et sans même s’essuyer les mains, elle part sur la route. Il avait crié après elle, mais elle ne s’était pas retournée. Et depuis lors, plus de nouvelles.
« Vous vous étiez disputés ? », que je lui demande. « Non », qu’il me fait. Les jours d’avant, elle était seulement plus taiseuse ou elle répondait plus sec. Moi, je flaire le pot aux roses. C’est une femme qui se renferme trop sur elle-même. Ça s’accumule pendant des mois et des années, puis ça explose. À certaines périodes, je sens que j’aurais pu faire pareil si je n’avais pas eu mon commerce. J’aurais rempli ma valise et j’aurais laissé Nestor et les enfants pour m’en aller je ne sais pas où. Oui, j’en aurais été capable. Enfin, ce n’était pas le moment de resonger à mes anciens problèmes, j’avais assez avec celui de M. Alain. Je sais bien qu’avec les jeunes on ne doit pas trop vite croire le pire, mais enfin, on ne sait jamais, et il faut un peu se mettre à la place du mari.
J’ai baissé mon volet, j’ai prévenu Nestor et j’ai été en face m’occuper de la petite. Les légumes étaient encore à moitié épluchés sur la table de la cuisine. M. Alain n’avait rien mangé de la journée, lui qui est si à cheval sur l’heure des repas. C’est dire s’il avait l’estomac serré… J’ai donné le bain à Géraldine, je lui ai fait son souper et je l’ai mise au lit. Puis je suis restée sans demander la permission car les hommes, quand une chose pareille leur arrive, ils sont encore plus perdus que les femmes.
Téléphoner… Chez lui, c’était quasi une idée fixe. Lui qui ne voulait pas faire installer le téléphone, tout d’un coup il ne pensait plus qu’à ça. Téléphoner à qui, je vous le demande ? À la maman qui habite en France ? Comme si sa dame s’était embarquée pour la France en blues jeans et en espadrilles, sans même une valise ni un manteau. Il parlait même d’avertir la police. « Allons, M. Alain, que je lui disais, soyez un peu raisonnable. On lave son linge sale en famille. Il est encore trop tôt pour ameuter le monde ». Mais quand on a eu dépassé minuit, moi aussi j’ai commencé à devenir inquiète.
Je me rappelais l’histoire de ma fille quand elle a rompu avec son mari. Vous savez, être appelée en pleine nuit à la clinique, et voir sa fille dans un lit, en salle commune, avec une figure encore plus blanche que l’oreiller parce qu’elle a ouvert le gaz… C’est des choses qu’une mère n’oublie pas. Et on songe qu’à seize ans, elle était si fraîche, si jolie, qu’elle pouvait épouser qui elle voulait. Qu’est-ce que les filles d’aujourd’hui ont dans la tête ? Un brave mari rangé, sérieux, travailleur, ça ne les intéresse plus. Mais les paumés sans métier, mal habillés, avec leurs cheveux dans les yeux, c’est à ceux-là qu’elles font les doux yeux. Ce que nous cherchions, nous, en nous mariant, c’était un avenir assuré. On mettait toutes les chances de son côté pour fonder un bon ménage, où les enfants puissent grandir tranquilles sans être tiraillés d’un côté et de l’autre.
Enfin, je remuais tout ça dans ma tête, installée avec M. Alain dans le nouveau salon. Car maintenant qu’il était privé de sa petite dame, il ne faisait plus de chichis pour s’y asseoir. Et son chien avait posé la tête sur ses genoux et n’arrêtait pas de le regarder, comme s’il comprenait ce qui arrivait. Et un peu après minuit, nous avons entendu la porte de la cour qui s’ouvrait tout doucement. Nous avons sauté de nos fauteuils pour aller voir… La petite dame était en train de se recoiffer devant la glace de la cuisine, pâle, les traits tirés, mais très calme comme si rien ne s’était passé. Mais lui, il l’a prise dans ses bras, et il a éclaté en sanglots comme un gosse. On aurait dit un petit garçon qui se réfugie près de sa maman, alors qu’il est deux fois plus grand qu’elle.
Moi, je me suis retirée sur la pointe des pieds, sans demander mon reste. Mais le lendemain, M. Alain, délicat comme il est, est venu s’excuser pour tout le tracas qu’il m’avait donné, et il m’a raconté l’affaire. Sa petite dame s’était promenée pendant des heures dans la campagne et dans les bois, marchant droit devant elle, sans se demander où elle allait. À un moment, il a bien fallu qu’elle s’arrête et qu’elle se repose. Mais elle n’avait pas un franc sur elle pour boire dans un café ou donner un coup de téléphone. Et une personne aussi fière, elle se laisserait mourir de faim et de soif plutôt que de demander quelque chose à quelqu’un qu’elle ne connaît pas. Alors, elle s’est remise en route, les pieds tout écorchés. En plus qu’elle s’était trompée deux ou trois fois de chemin… Et voilà. Le résultat, c’est que huit jours après, M. Alain faisait la demande pour avoir le téléphone. Il aimait encore mieux que sa femme ait son échappement de ce côté-là plutôt que de s’encourir à travers champs.
Des histoires comme celles-là, on finit par en rire. Ce n’est rien à côté de l’émotion que m’a donnée François le premier samedi d’octobre. Ce matin-là, Sœur Émilie passe au magasin pour acheter son « gaudeamus » comme elle dit. Chaque premier dimanche du mois, dans leur congrégation, on fait un petit extra, paraît-il. C’est même écrit dans leur règle. Sœur Émilie continue à le fêter avec Sœur Laurence et la veille elle vient choisir une petite friandise chez moi. Voilà donc qu’elle s’amène au magasin et qu’elle me fait : « Quel malheur, Nelly ! Vous avez appris avec François ? ». « Quoi ? Il lui est arrivé quelque chose ? ». « On dit qu’il a un cancer ».
Ça m’a fait un coup ! François, je dirais bien que je le connais depuis que je suis née. Je le revois toujours dans la cour des garçons, quand j’étais chez Sœur Augusta qui est morte maintenant. Dire qu’on était tous ensemble à l’école, il y a cinquante ans, François, Nestor, Clovis, Maria et qu’on jouait dans les deux cours, avec seulement la haie pour nous séparer des garçons. C’est surtout François que je revois avec ses cheveux tout bouclés, ses yeux noirs et son chandail rouge. Il faut dire aussi qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour se faire remarquer des filles ! Sur le chemin de l’école, il escaladait les clôtures et il grimpait aux arbres pour marauder les fruits. Et nous, on tendait nos tabliers pour qu’il y jette des poignées de cerises et de mirabelles. Il aimait bien faire le malin et le généreux, il n’a pas changé.
Quand j’ai commencé à danser, à vingt ans, il en avait vingt-quatre, et malgré tout le succès qu’il avait, il ne se décidait pas. En ce temps-là, je vous avoue que c’est lui que je regardais et pas Nestor. Et il n’aurait pas fallu tellement pour que ça se décide entre nous deux. Je me souviens d’un bal de nouvel an où nous nous étions retrouvés ensemble. Je ne suis pas une beauté, je ne me suis jamais fait d’illusion de ce côté-là, mais à vingt ans, il faut si peu de chose pour faire de l’effet sur les hommes ! Ce soir-là, j’étais à mon avantage, j’avais une robe qui m’allait bien. Et tout ce que je peux vous dire, c’est que François m’avait fait beaucoup danser. Il faut savoir saisir sa chance. Moi, je l’ai laissée échapper. On nous avait mis tellement d’idées dans la tête, qu’il fallait être réservées, ne jamais faire le premier pas dans la direction d’un garçon. Je me suis montrée comme un glaçon, et jolie comme ce soir-là, je ne l’ai plus jamais été. François s’est décidé pour Maria.
Un cancer à soixante-deux ans ! J’en avais les jambes coupées. La première fois que Maria est venue au magasin, je n’ai pas pu me retenir. Je lui ai demandé quoi. Elle s’est mise à rire : « Voilà quatre ans que ça dure, son cancer… » Et elle m’a tout raconté. On avait pris deux fois des radios. Il avait passé tous les examens. Il n’avait rien. C’était une idée fixe. Vous imaginez, un homme comme François, actif, gai, prenant la vie par le bon côté, et qui tout d’un coup se met à avoir des idées pareilles ? Est-ce que c’est les radiations, les satellites qui tournent au-dessus de notre tête, les expériences que font les Russes et les Américains ? Nos parents avaient quand même plus de plomb dans la cervelle.
Le changement de saison, ce n’est pas non plus très bon pour le moral. Quand les cerisiers perdent leurs premières feuilles et qu’on se dit : l’automne approche, Nestor est de nouveau à plat. Un matin, il me fait : « Je vais sur la tombe de mes parents ». Dieu sait pourtant que son père a été sévère avec lui, le forçant à demander toutes les permissions jusqu’à son service militaire. Et sa mère était une femme tellement petite et effacée qu’on ne parvient pas à se souvenir comment elle était. Mais Nestor a gardé une dévotion pour eux deux, au point que ça devient quelquefois maladif.
Il me dit : « La Toussaint approche, je vais voir si tout est en ordre sur la tombe ». Et le voilà parti au cimetière. D’un côté, ça le pousse à prendre l’air et c’est bon pour lui, mais aussi ça le fait pleurer sans raison au beau milieu de la journée. « Au moins, ne va pas tout seul, que je lui dis, pars avec Sœur Émilie », puisque hiver comme été, elle va au moins deux fois par semaine sur la tombe de son « petit aumônier ».
C’est une affaire, Sœur Émilie et son « petit aumônier » ! Ça remonte à plus de vingt-cinq ans. Le dernier aumônier des Sœurs, c’était M. l’abbé Gailuron, un vieux prêtre tout blanc, tout cassé qui avait été finir là ses vieux jours. Quand il est mort, il aurait été question de l’enterrer dans le caveau des Sœurs. En ce temps-là, elles étaient encore quatre ou cinq dans leur communauté, et toutes étaient d’accord, sauf Sœur Saint-Pierre qui était supérieure.
Être couchée comme ça à côté d’un homme, disait-elle, jusqu’à la Sainte Résurrection, ça ne lui semblait pas convenable. Alors, on a enterré le vieux prêtre à l’autre bout du cimetière, et Sœur Émilie en a gros sur le cœur. Sans doute qu’elle a peur qu’il s’ennuie tout seul dans son coin. L’été, elle lui porte des fleurs. Depuis vingt-cinq ans ! Les gens disent en riant qu’elle en est encore amoureuse. Eh bien moi, je trouve ça beau. Alors que les jeunes ne s’aiment plus au bout de deux ans et divorcent, elle est toujours amoureuse de son petit aumônier. Il doit lui donner l’absolution de là-haut, le cher homme !
Maintenant, pendant les week-ends, presque toutes les secondes résidences sont vides. Dans une région comme celle-ci, il y a trop de monde l’été et pas assez l’hiver. On n’est jamais content. Après la Toussaint, je n’ouvre plus le dimanche et ça devient pour moi le plus mauvais jour de la semaine. Je tâche de faire pour Nestor un petit dîner spécial, mais depuis sa dépression, il ne trouve plus goût à rien. On mange sans parler, comme des bêtes au râtelier. Et l’après-midi, le village est mort, mort… On n’a pas idée. Avant la guerre, au temps du curé Genot, on tournait quelquefois des films muets au cercle Saint-Julien. François était président de la dramatique et jouait encore des pièces, en français et en wallon. Et aux entractes, Clovis y allait de son petit couplet. Quelle voix ! Il aurait pu faire de l’opéra. Ma pauvre Sœur Hortense vivait encore, et elle riait si volontiers quand c’était une pièce comique ! Moi, je ne faisais qu’un petit rôle de temps en temps, mais ça m’amusait d’aller aux répétitions et d’être avec les autres. Et on organisait des bals dans la salle du café Beuken, et après la guerre, il y eu le ciné Louxor qui a été obligé de fermer depuis à cause des télévisions. Maintenant, il n’y a plus rien de rien. Les gens restent accrochés à leur petit écran et les jeunes vont s’amuser Dieu sait où sur leurs motorettes.
C’est en hiver qu’on se sent le plus vieillir. Tout en dressant mon inventaire, je fais le compte des années que j’ai vécues. Je me dis : « Une de plus que l’an dernier… ». Si on pouvait revenir en arrière ! Je m’amuse à ça quelquefois, quand je m’éveille tôt et que je ne sais plus me rendormir. J’imagine que je vais me lever pour partir à l’école. Je mettrai mes petits sabots rouges et la capeline que ma grand-mère m’a tricotée. On ne doit pas encore faire attention aux autos sur les routes, en ce temps-là… Il en passe une toutes les heures. On ne parle pas de bombe atomique, ni de pollution. On n’a pas la radio ni la télévision pour vous donner les mauvaises nouvelles. J’avais dur, chez mes parents. Quand je rentrais à quatre heures, il fallait traire et faire la bouillie des cochons. Mais on était contents avec si peu ! La fête du village une fois l’an, et on y pensait six mois à l’avance. Les fruits de ses arbres qu’on faisait sécher sur le poêle, les légumes qu’on hivernait dans ses caves, et on n’avait jamais faim, et on n’avait pas l’impression de manquer. Est-ce qu’on mange mieux maintenant qu’on a des frigos et qu’on ne consomme plus que des produits avec des étiquettes ? Même les chats ne veulent plus n’importe quoi dans leur assiette. Il leur faut des boîtes à leur marque ou ils font la grève de la faim.
Ou bien j’imagine que la guerre vient juste de finir et que j’ai dix-huit ans. Comme on était heureux ! On se laissait vivre. On était sûrs qu’on ne se battrait plus jamais. On gagnait facilement de l’argent, on avait confiance dans l’avenir. On allait se marier et avoir des enfants et tout ça semblait réglé comme du papier à musique…
Eh là, Nelly, qu’est-ce qui te prend ? Tu vas faire ta petite déprime pour te rendre intéressante ? Allez, ma fille, secoue-toi ! Tu en as vu d’autres. Mets un peu la radio pour te changer les idées, écoute le feuilleton de 10 heures. Et le soir, quand tu baisses ton volet, dis-toi que c’est un jour en moins à attendre le printemps.