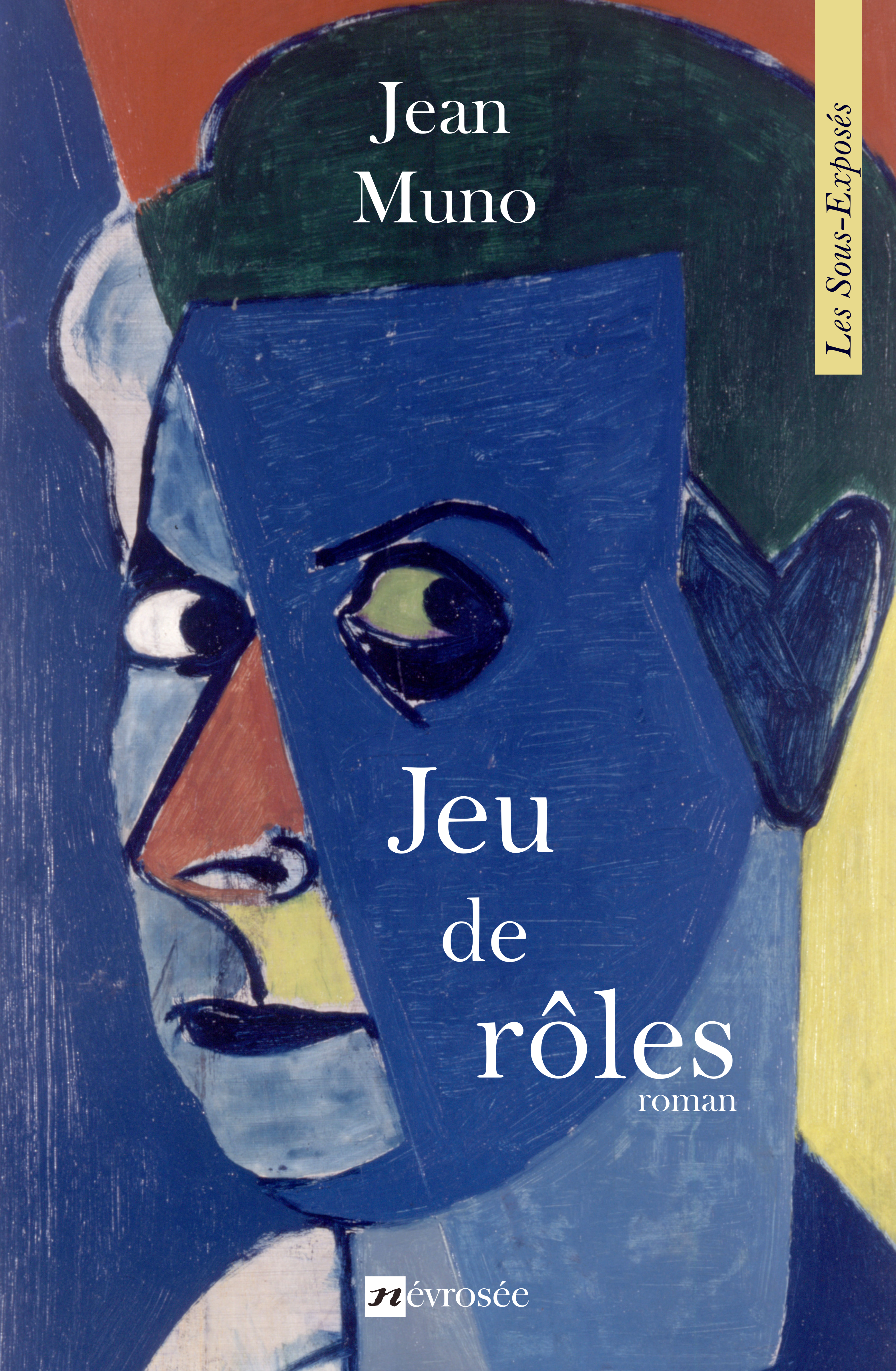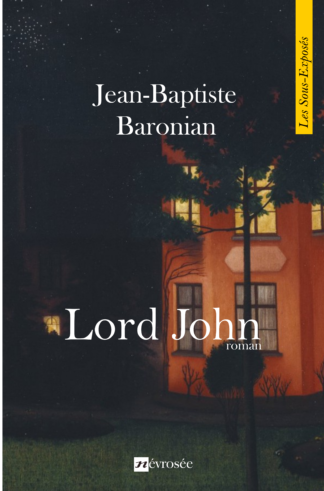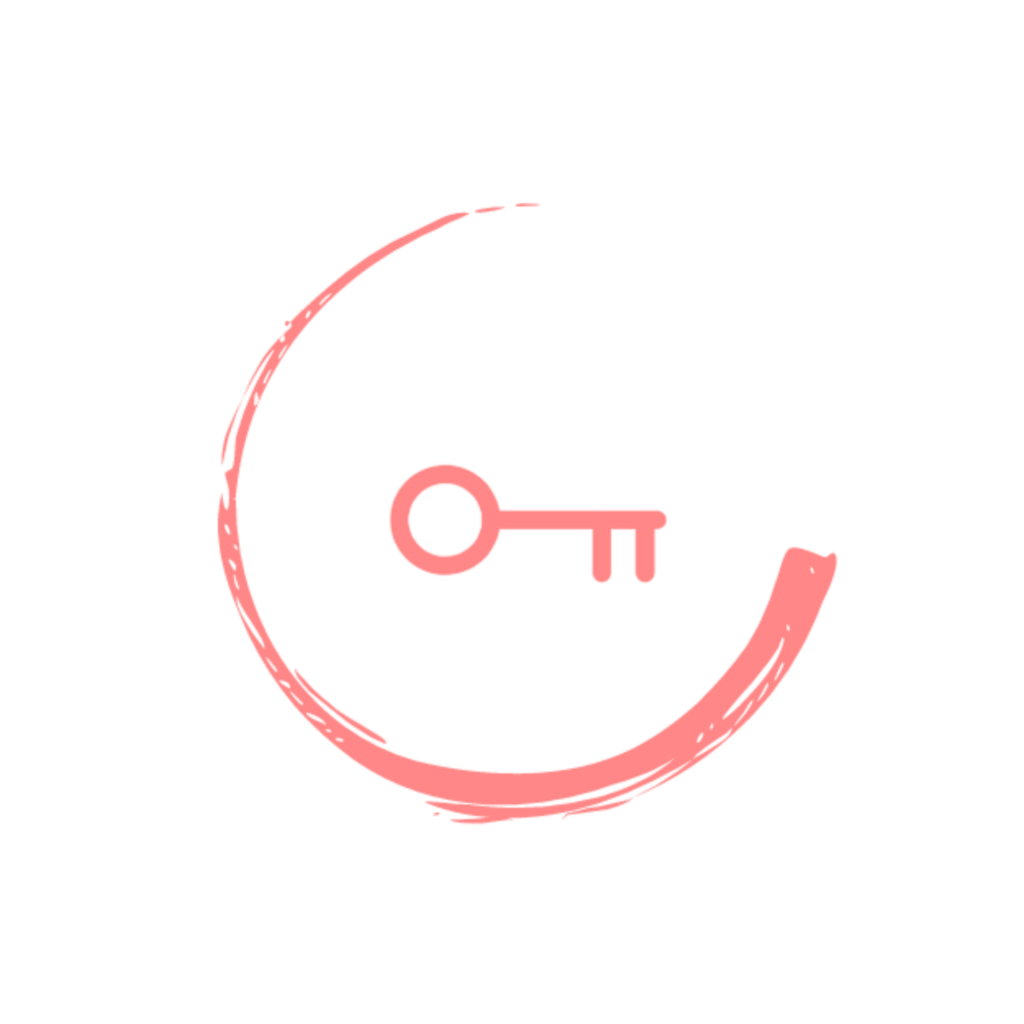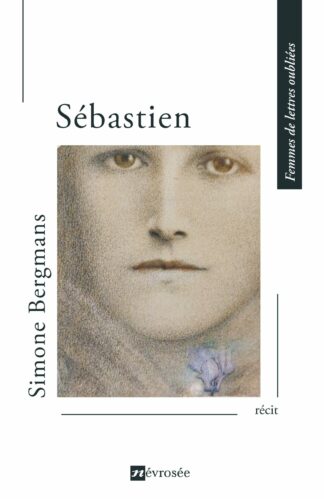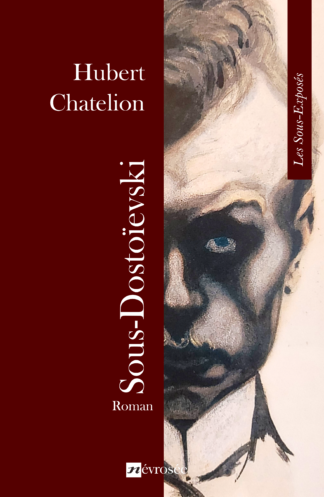I
— Fabre ! … Fabre ! Les poubelles ! C’est le jour ! … Fabre ! Le téléphone ! Ta mère ! C’est toi qu’elle veut ! … Fabre ! J’entends le camion ! Ne compte pas sur moi pour courir derrière ! … Ta mère s’énerve, Fabre ! Elle croit que tu ne veux pas venir au téléphone parce que tu lui caches quelque chose… Réponds ! … Tu dors, ou quoi ? … Ce n’est pas possible ! Tu dors encore ! … Incroyable ! Il dormait déjà ! … Fâââbre !
… La vie est routinière. Elle use. Papier émeri. On est ses employés jusqu’à la corde. Fabre, Marie-Agnès, tous les autres. À l’heure de la télé, les rues sont vides. La fiction fait le plein, la vie réelle n’est plus que l’ombre d’elle-même…
— J’ai …
— Quoi ?
— … sommeil…
Marie-Agnès – je la verrais blonde, élancée, cavaleuse, figure de proue… et pourquoi pas « joggeuse », en survêtement pastel, un bébé arrimé dans le dos… non, pas de bébé : ils n’en ont pas, n’en auront pas… ou alors, celui d’une copine, pour rendre service ? … – Marie-Agnès prétendait que Fabre dormait mal la nuit parce qu’il dormait trop bien le jour, qu’il prenait l’un pour l’autre et que c’était une manière sournoise de fuir ses responsabilités sociales.
Au bureau, c’est vrai que sa journée était comme un hamac suspendu entre les sacro-saintes pauses café. L’air conditionné, le décor géométrique, l’atmosphère moquette et l’épaisseur blême des dossiers : on peut comprendre. Et le zèle de Louise, sa secrétaire, qui avait une passion pour son IBM à sphères. Il partageait Louise avec Lemoine, équitablement, la matinée pour l’un, l’après-midi pour l’autre, mais Richard Lemoine, lui, n’en profitait pas pour dormir, tout au contraire.
Hors de l’enceinte du ministère, en tout cas, rien n’aurait dû justifier le recours systématique au sommeil. Mais la funeste habitude était prise. Le roupillon était devenu sa drogue, il profitait de la moindre occasion pour s’en faire une piquouse. Dans les transports en commun, aux toilettes, devant la télé, partout, sur toutes les chaînes. En mangeant, en marchant, en… Au jardin, par exemple, alors qu’il était censé retourner un parterre, Marie-Agnès le surprenait endormi, en équilibre sur sa bêche, la tête au creux de son bras replié. Pour lui donner une leçon, elle retirait brusquement le support, et le pauvre piquait du nez dans les mottes.
Même en faisant l’amour !
Chaque matin en revanche, dès potron-minet, après s’être longtemps retourné dans son lit, Fabre en sortait à tâtons, tout pétillant de vivacité retenue. Prêt à interpeller le monde. À lui donner la réplique, du tac au tac. Malheureusement le monde dormait encore, et notamment Marie-Agnès. Alors, n’ayant personne à qui parler, pas même un chat, il se réfugiait dans la cuisine où, fumant des cigarettes et buvant du café, il tournait en rond, en proie à un étrange bouillonnement d’idées et de sentiments. Tantôt silencieux, mâchoires serrées, tantôt se parlant avec les mains, parfois riant sous cape ou essuyant furtivement une larme, il guettait l’aube par le soupirail, le regard comme un ciel changeant, traversé de sentiments divers.
Beaucoup d’énergie et d’esprit d’à-propos se gaspillait ainsi, chaque jour, à la médiocre lumière d’une ampoule de 25 watts. En effet, durant les 2 ou 3 heures que duraient ses coquericos rentrés, Fabre – il s’agit d’un prénom : Fabre Déglantine, sans apostrophe à Déglantine – avait pris l’habitude de vivre sa journée par avance, sur un tempo accéléré, mais une journée autrement excitante, rebondissante, télégénique, que celle, trop prévisible, hélas ! qui l’attendait. L’ennui des jours ouvrables… et des autres, parfois… Dans le petit matin blême, ses comparses quotidiens se présentaient à son commandement. Le triste Lemoine, avec son air de faux jeton, Louise et son demi-sourire indécis de secrétaire partagée, mademoiselle Bécue, Berthe Bécue ! toujours évoluant de profil, la tête rejetée en arrière, le cou ployé comme celui d’un cygne. Pas une beauté, mais, tout de même, elle valait mieux que son nom.
Il y avait aussi Isabelle Dujardin, la mère de Fabre…
À la lueur des 25 watts relayée par la clarté filtrant du soupirail, l’insomniaque évoluait parmi ses personnages, le pyjama veule, le zizi indiscret. Dialecticien pourtant irrésistible. Soudain il s’immobilisait, le corps manifestement déserté, mais le visage animé d’expressions diverses, de la tendresse à l’indignation, de l’ironie à la stupeur douloureuse. C’étaient les moments où, juste après le lever du soleil, ses partenaires réduits au silence, Fabre leur parlait un peu de lui-même, de son vrai visage : l’homme nu, méconnu, ses mobiles secrets, ses intentions mal perçues, ses contradictions apparentes mais sa cohérence profonde, bref, tout ce qu’il fallait savoir pour le comprendre, lui rendre justice, et qu’il était le seul à pouvoir exprimer puisque, de toute évidence, personne ne connaissait mieux Fabre que Déglantine et vice versa. Discours inattaquable, d’une rigueur diabolique, qu’on eût aimé pouvoir graver une fois pour toutes dans quelque chose de très dur ; point d’orgue et justification de l’insomnie que grignotait inéluctablement la montée de la lumière.
En effet, à mesure qu’il pénétrait par le soupirail, le jour faisait pâlir la lampe et décliner l’euphorie de Fabre. Le doute s’emparait de lui, cet écœurement de tout l’être qui, le plus souvent, ternissait ses journées. À quoi bon ? se disait-il, ils ne m’écouteront pas… Et s’ils m’écoutent, ne me comprendront pas… Et s’ils me comprennent, ne me croiront pas… Et si, d’aventure, ils m’écoutent, me comprennent et me croient, jamais ils n’auront l’honnêteté de l’admettre. Je dérange. Pourtant je ne le fais pas exprès. Je suis… je ne suis bien nulle part, ni parmi les autres ni en moi-même… Un perpétuel faux bond… Résultat : à sept heures et demie, quand Marie-Agnès descendait, elle ne trouvait plus en face d’elle qu’un petit homme cuvant son ivresse déçue, triste comme un mégot. Elle, en revanche, fraîche et joyeuse ! Soleil ou pluie, elle rayonnait toujours.
En un mot, Fabre vivait à contretemps. Trop tard ou trop tôt ; encore endormi, déjà réveillé. Son rythme était celui des oiseaux qui, dès avant le lever du jour, pépiaient frénétiquement dans les arbres de l’avenue du Bourgmestre. Des passereaux, j’imagine. Mais au lieu d’être passereau, il était homme, et même fonctionnaire, appointé de l’État. Parfois il venait à en douter, à penser qu’on s’était trompé d’enveloppe, que sa nature intime était plus arboricole et volatile qu’humaine et administrative. Qu’il se trouvait en exil dans un corps déplumé.
Cette intuition mélancolique était de celles qui lui donnaient envie de nidifier dans les ramures du sommeil.
« Pourquoi, bon sang, ai-je épousé ce somnambule somnolent ? » s’était longtemps demandé Marie-Agnès. Que répondre ? Sans beaucoup de résultat, elle avait posé la même question à quelques-unes de ses amies que la psychologie intéressait. Jusqu’au jour où un jeu télévisé lui avait appris que son mari portait le même nom, à l’apostrophe près, que le sympathique auteur d’Il pleut, bergère ! Chouette, non ? Poète et guillotiné, comme ça va bien ensemble ! Et quelle revanche pour qui est née Pichet ! Elle s’en vanta beaucoup, et même, à l’occasion, emprunta l’apostrophe et le d minuscule. Désormais elle savait pourquoi elle avait épousé ce rêveur d’autrefois, ce doux Jean de la Lune auquel des méchants avaient volé sa tête : en souvenir d’une chanson d’enfance.
En général, Marie-Agnès n’avait pourtant rien d’une nostalgique. Bien d’autres chats à fouetter ! On disait qu’elle avait de la vitalité pour deux, et rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Le sourire toujours un peu commercial, elle vous donnait en remerciement un rapide aperçu de son emploi du temps : jogging, power training, stretching, aérobic, squash, moto, trempolino, etc. – peut-être qu’elle en rajoutait, emportée dans son élan – le tout coupé de quelques interludes nécessaires : banc solaire, époussetage dansé, pressing musical, méditation basses calories, lunch transcendantal… À ce régime, forcément, elle tenait une forme insolente pour tous, mais particulièrement pour l’homonyme frileux d’Il pleut, bergère. Que faisait-il, lui, pour sa condition ? Rien. Le bureau le jour, l’insomnie la nuit. Entre les deux, les transports en commun, le cholestérol à la cantine, le foot à la télé. J’oubliais : sa sucette à Nicot ! Si, au moins, il s’était payé un bon docteur de temps en temps, ne serait-ce que pour rassurer les gens sains !
Naturellement, Marie-Agnès croyait que tous nos maux viennent du corps : le foie, la rate, le grand sympathique, etc. Sans oublier la plante des pieds. C’est pour irriguer la plante que nous pratiquons le jogging. Le corps sain fait l’âme saine. Fabre, lui, était persuadé du contraire : ses malaises, il le sentait bien, résultaient de ce quelque chose de volatil, de primesautier, de gazouilleur, qui se trouvait captif en lui comme dans un ministère. « Idiot ! se récriait Marie-Agnès. Tu t’écoutes au lieu d’agir ! »
À quoi bon s’exposer aux fatigues d’une discussion qui ne pouvait être que stérile ? Ses opinions n’avaient jamais prévalu que dans le no man’s land du petit jour. Fabre finit donc par se laisser conduire chez le docteur qui traitait Marie-Agnès depuis des années, la considérant comme une de ses meilleures patientes, en constant progrès, affirmait-il volontiers.
Ce docteur était une doctoresse. La quarantaine, demi-lunes en bout de nez, assez intimidante. Quand elle eut Fabre devant elle, nu jusqu’à la ceinture, grêle et pâlot, sa première expression fut de surprise navrée. Aucun commentaire, mais l’in petto se devinait sans peine : comment Marie-Agnès, si maîtresse de son corps, pouvait-elle tolérer cette pauvre chose à ses côtés ? Elle interrogea. Méticuleux comme d’habitude, l’appointé de l’État fit l’inventaire des symptômes dont il était le théâtre. Tous ramenaient à ce funeste va-et-vient : insomnie-somnolence, euphorie-dépression. Il ne parla ni des oiseaux ni des sentiments fraternels qu’ils lui inspiraient, car il craignait de passer pour un poseur. En revanche, étendu sur la table, le regard au plafond, il trouva des mots venus du profond de lui-même pour exprimer le sentiment de déréliction qui, dès potron-minet, endeuillait ses journées. La doctoresse l’aidait en lui pressant vigoureusement le ventre.
— Parfait. Rouillé, mais rien d’alarmant.
Déglantine se redressa avec un demi-sourire un peu fat : il l’avait toujours dit, lui, que son énigme n’était pas corporelle. La doctoresse le questionna : son métier, ses loisirs, ses passe-temps… Il expliqua : c’était bien simple. Extrêmement bien simple.
— Vous ne vous ennuyez jamais ?
Jamais ! Comment osait-elle dire jamais ? Il répondit :
— Parfois.
Il ajouta modestement :
— Comme tout le monde.
Il rajouta, pour justifier :
— La vie…
(Mais que faire d’une phrase qui débute imprudemment par La vie ?)
— Qu’est-ce qu’elle a, la vie ?
— Rien… justement.
— Faut la changer !
— Ça ! soupira Fabre, les yeux au ciel, en passant frileusement sa chemisette.
— Agir, merde ! excusez-moi… Vous prendre en mains. Inventer !
Inventer ! Est-ce qu’elle inventait, elle ? Il l’énervait un peu, d’accord, sa logique, sa franchise… pas une raison pour le brusquer !
— Facile à dire.
— Le bricolage ? Non ? … Et les arts ? L’aquarelle ? Le lavis, c’est amusant… Ou collectionner. Pourquoi pas ? Selon ses moyens. Je connais quelqu’un qui collectionne des dessous de bocks, et il assiste à des congrès, même à Paris, subsidiés !
Fabre eut un demi-sourire navré : des dessous de bocks, non merci, vraiment, il ne se voyait pas réduit à cette extrémité…
— Et la lecture ? Un bon bouquin de temps en temps, hein ?… Ou alors, je ne sais pas, moi… la Poésie. Le Poète est un rossignol !
Là, franchement, elle s’égarait. Il haussa les épaules.
— Je n’ai pas parlé de ma vie, mais de la vie. Vous comprenez ? La vie ! Ce n’est pas moi qui peux changer la vie.
— Et pourquoi pas ? La vie est à tout le monde.
— La mienne, non. À personne. Même pas à moi.
— J’ai dit la vie, Monsieur. La !
Vétillard et confus. J’ai vu un téléfilm dont j’ai oublié le titre (ça me reviendra peut-être…) où, dans des circonstances assez semblables, sauf que la scène se déroulait par gros temps, sur un cargo mixte, au large de Mourmansk (voilà le genre de détails oiseux que je retiens !) une infirmière à bout d’arguments finit par se déchausser et par enlever ses collants. La scène m’a frappé parce qu’il est bien rare au cinéma de surprendre une femme en train d’enlever ses collants (ses bas, oui, c’est banal) ce qui prouverait s’il en était besoin combien la fiction même réaliste diffère de la réalité. Malheureusement, ce n’est pas le genre de surprise que la doctoresse réservait au héros de cette histoire. Après l’avoir dévisagé un instant, comme si elle cherchait à lire en lui, elle se contenta de proposer :
— Et si vous écriviez, monsieur Déglantine ? Déjà vous portez un nom de poète.
— Guillotiné, précisa lugubrement Fabre. (C’était sa réplique lorsqu’on faisait mine de lui refiler les blancs moutons de l’autre.) Et d’abord, écrire quoi ?
— Ce qui vous passe par la tête.
— Macabre, fit-il remarquer.
— C’est un moyen de changer la vie, vous ne pensez pas ? Il y eut un silence. Fabre cherchait vainement la riposte. On peut toujours écrire, c’est clair, n’importe qui sur n’importe quoi, des mots qu’on surprend dans la rue, le métro, ou alors dans sa tête, oui, débarqués on ne sait d’où par phrases entières, même que l’idée de les écrire lui était déjà venue plus d’une fois, comme elle vient tôt ou tard à tout le monde, j’imagine, dans les moments creux… Dormir ou écrire ?
— Pourquoi ne pas essayer, monsieur Déglantine ? Un petit poème de temps en temps, ça vous ferait du bien.
L’ingénuité de cette doctoresse le désarmait. Il ne voyait pas les Muses ainsi.
— Vous me les montreriez, nous en discuterions. Je vous donnerais mon avis, en toute simplicité. Homéopathiquement, si j’ose dire. C’est ainsi que les poètes font…
Pour planter leurs choux ! Elle avait dit ça d’une voix de gorge, comme mouillée de ferveur. Troublée, troublante. Et Fabre comprit soudain où elle voulait en venir : on n’était plus dans la médecine, mais dans les belles-lettres ; elle écrivait, la garce, aucun doute là-dessus, et pas que des ordonnances ! Des poèmes, des aphorismes, des impressions de voyage… du texte, quoi ! Contre l’ennui, l’oubli, contre le temps qui passe. Sa bouteille à la mer… Tout compte fait, le cargo mixte, ce n’était pas si mal vu. Sauf qu’ici, au lieu de ses fesses, elle décapuchonnait son stylo.
Quelque chose d’écœurant dans tout ça. Fabre se sentait soudain de très mauvaise humeur.
— Non, vraiment, ça ne me tente pas. À quoi bon d’ailleurs ? Écrire pour qui ?
— Pour vous-même ! fit la doctoresse avec un élan de tout l’être.
Il l’aurait giflée.
Mis à part son nom, qu’il doit au hasard, Fabre est un personnage très ordinaire, plein de contradictions très ordinaires. En quittant la doctoresse, et quoi qu’il ait pu lui dire, il se rendit chez le papetier (l’ordonnance préconisait la gomme et le crayon afin de combattre l’effet pernicieux des ratures) et le lendemain, dès potron-minet, prit place derrière la table de la cuisine. Docilement, entre un dictionnaire et une grammaire simple et complète, car deux précautions valent mieux qu’une.
Il ouvrit son gros cahier cartonné avec le sentiment d’y mettre malgré lui quelque solennité. Tailla le crayon. Huma la gomme, qui fleurait bon l’enfance. Tendit l’oreille. Les oiseaux pépiaient comme jamais, ce qui lui parut de bon augure. Il alluma une cigarette, la première, et guetta en lui, pour l’attraper au vol, le surgissement du monologue habituel.
Rien ne vint.
Seuls les passereaux chantaient.
Inexplicablement, le soliloque quotidien était tari par la page blanche.
N’importe quoi, se dit-il, il faut se lancer… Non ! Ce qui me paralyse, justement, c’est cette idée. Pas facile d’écrire n’importe quoi.
Il pensa à Fabre d’Églantine, se chantonna intérieurement Il pleut, bergère… D’où il était, son poète, il aurait pu lui donner un coup de main, non ? Après tout, c’était un peu de lui qu’il s’agissait. De sa résurrection. De sa métempsycose !
Mais rien. Pas un souffle. Rien que les passereaux. De quoi perdre contenance…
Contenance vis-à-vis de qui ? Je suis seul !
Il tailla de nouveau son crayon, la mine se brisa, il retailla.
Et si je transcrivais tout bonnement ce que j’entends ? Ce qui tombe de l’arbre, sans autre prétention que de me mettre en train… Il écouta, réfléchit, puis écrivit avec soin tout en haut de la page : Cui cui cui. Ensuite, plus subtilement : Tchuitt ! Tchuitt ! Enfin d’un seul élan : Zettî ! Zettî ! Zettî l… Tchuitt ! Zettîcuicui… Tchuitt ! Zettî-cuicui-tchuitt !… Ridicule. Les oiseaux n’ont aucune imagination. Il effaça, un plaisir : la gomme était excellente. Mais pour avoir l’occasion d’effacer, il faut écrire. Il alluma une autre cigarette et retendit l’oreille comme un pêcheur lance sa ligne. Trémolos, fioritures, dentelle. Cependant, derrière cette virtuosité qui égarait l’ouïe, il crut discerner quelque chose de moins volatil. Comme un vocable, qu’on aurait pu prendre pour un appel…
Il transcrivit : Grrô… Z… I… Grozetti…
Un nom ?
C’est important, un nom. On prétend qu’il y a des écrivains, et non des moindres, chez qui tout part de là. Nom, prénom, adresse, état civil… et le personnage se met à vivre. Grozetti, Vittorio… Monsieur Vittorio Grozetti… Marco… Guglielmo… Il n’avait même pas eu à chercher dans les annuaires, ce Grozetti lui était littéralement tombé des nues !
Sur la page de gauche, il écrivit en note : Grozetti, Vittorio, 41 ans, Italien (forcément !). Il ajouta : Florence. Se ravisa, remplaça Florence par Pise (du beurre, cette gomme !) à cause de la Tour penchée (il « visionnait » particulièrement bien la Tour penchée). Il précisa : célibataire, voyage beaucoup. Pour quelle raison ? Import-Export, évidemment.
Facile ! Question de méthode…
Sur la page de droite, réservée au texte même, il calligraphia :
L’AFFAIRE GROZETTI
Point à la ligne.
Un peu simple, non ? N’a-t-on pas l’impression que le type qui a écrit cela avait envie d’en être débarrassé ?
Il ajouta PÈRE ET FILS.
L’AFFAIRE GROZETTI, PERE ET FILS.
Ouais… Une rue de province, des pavés inégaux, une boutique tranquille à l’ombre de la cathédrale. Colifichets, rubans, fleurs artificielles. Grandeur et décadence d’une entreprise familiale… À l’image de la cathédrale se substitua celle de la Tour de Pise toute pétaradante de coups de feu. La fameuse « affaire Grozetti » ! Ni père ni fils : le Clan. Il effaça l’ajout. Merci, la gomme !
L’AFFAIRE GROZETTI
Comme cela, c’était un titre. Le titre. Une affaire tout à la fois politique, policière et mafiosante… Sentimentale aussi… un peu… pas trop. Cinématographique en tout cas. Les acteurs, à part Grozetti, seraient ceux du petit matin : Lemoine, Louise, mademoiselle Bécue… lui-même, évidemment. Acteur et metteur en scène. En passant, il dirait leur fait à certains. Berthe Bécue serait particulièrement à sa place dans une affaire comme celle-là, il y avait du mystère en elle, quelque chose d’ambigu, d’oblique, de… Elle pourrait même en être l’âme, à condition de lui trouver un autre nom, plus en rapport avec son profil andalou.
Et Isabelle Dujardin ? L’ennui, avec Isabelle, c’est qu’elle ne se tient jamais à sa place. Faut qu’elle se pousse, même à son âge.
Et la tricoteuse… Elle, c’est tout le contraire : si discrète qu’on risque de ne pas la voir. D’ailleurs, je ne connais pas son nom, et la plupart sont dans mon cas. Jamais les mains vides, pas une minute à perdre, son zèle paraît absurde… Moi, c’est seulement pour me faire plaisir que j’aimerais parler d’elle. Pour la rencontrer vraiment, si c’est possible, car d’habitude on ne fait que la croiser. Comme une inquiétude, une interrogation, une nostalgie, le tout ensemble. Une tentation aussi. Pourtant elle a l’air si simple. Peut-être qu’elle cherche à se faire oublier, qu’elle veut être en même temps familière et troublante, troublante à force d’être terriblement familière… Un piège, qui sait ? C’est l’impression qu’elle m’a toujours faite en tout cas, surtout en automne.
Sur la page de gauche, Fabre écrivit d’une traite, comme sous la dictée :
Rachel Maron, ex-Berthe Bécue.
D’origine espagnole. Née en 1941. Célibataire. Un ami ? Une amie ? Ses parents ont quitté l’Espagne lors de la guerre civile.
Directrice au ministère. Service des dossiers en souffrance (SDS).
Avenue de l’Université, 3e Et. Des fleurs partout. Ni tulipes ni glaïeuls.
Avec Lemoine, c’était le personnage qu’il avait le mieux en tête. Depuis longtemps. Il revint à la page de droite, et son crayon se mit à courir. D’une ligne à l’autre : zig… zag… zig… comme un clébard qui suit une piste, la truffe au sol. Une demi-page déjà. Et bientôt, alors que la lumière du jour commençait à se répandre sur le carrelage, il put passer à la suivante. Cela venait tout seul, grâce à ses comparses familiers. Une bonne petite équipe, parfaitement rodée. Depuis le temps ! D’entrée de jeu – de jeu précisément, car cette fois on avait sauté le pas : on jouait – la belle Maron avait été trouver Lemoine dans son bureau. « Je ne vous dérange pas ? — Au contraire, je… » Une lubie. Tête de Cactus ! Une femme, cette femme-là ! dans son antre !… Par hasard. Parce qu’elle n’avait rien de mieux à faire, qu’après s’être disputée ce matin-là avec son ami (son amie ?) poussée par… elle cherchait à… Au fait, qu’est-ce qui la poussait à transgresser la routine ?
Fabre releva la tête, regarda fixement le soupirail. Il réfléchissait. Vacuité ? Hasard ? Ennui ? De tout un peu ? Trop tôt pour le savoir. D’ailleurs, ce matin-là, personne n’aurait songé à se poser la question… Il faut respecter les règles du jeu.
La doctoresse avait été de bon conseil. Il écrirait pour changer… disons, quelque chose à la vie, histoire de l’allumer un peu, de lui rendre du vif. Ce devait être possible. Et, à la longue, peut-être qu’il se retrouverait moins employé, encalminé ? Requinqué de l’intérieur, qui sait ?
Écrivain du dimanche ? Pas exactement. De l’aurore, plutôt, de l’aurore des jours ouvrables. De l’euphorie des passereaux.
À la question : « Pourquoi écrivez-vous ? » il répondrait, comme la bergeronnette grise : Tsi-si-siff-tsi-vitt, puis, réfléchissant, ajouterait comme le pouillot siffleur voltigeant d’arbre en arbre : Sip-sip-sip-sirr… Di-u-di-u !
— Je vous remercie, monsieur Déglantine.
— Zi-zi ti-ti…, dit et redit la mésange longue queue, ce qui signifie : « De rien, je vous en prie… »
Tout cela, en vérité, n’était-il pas un peu prétentieux ?