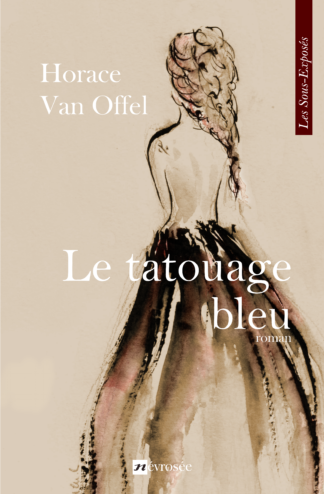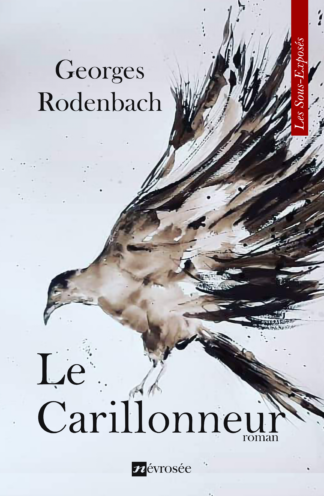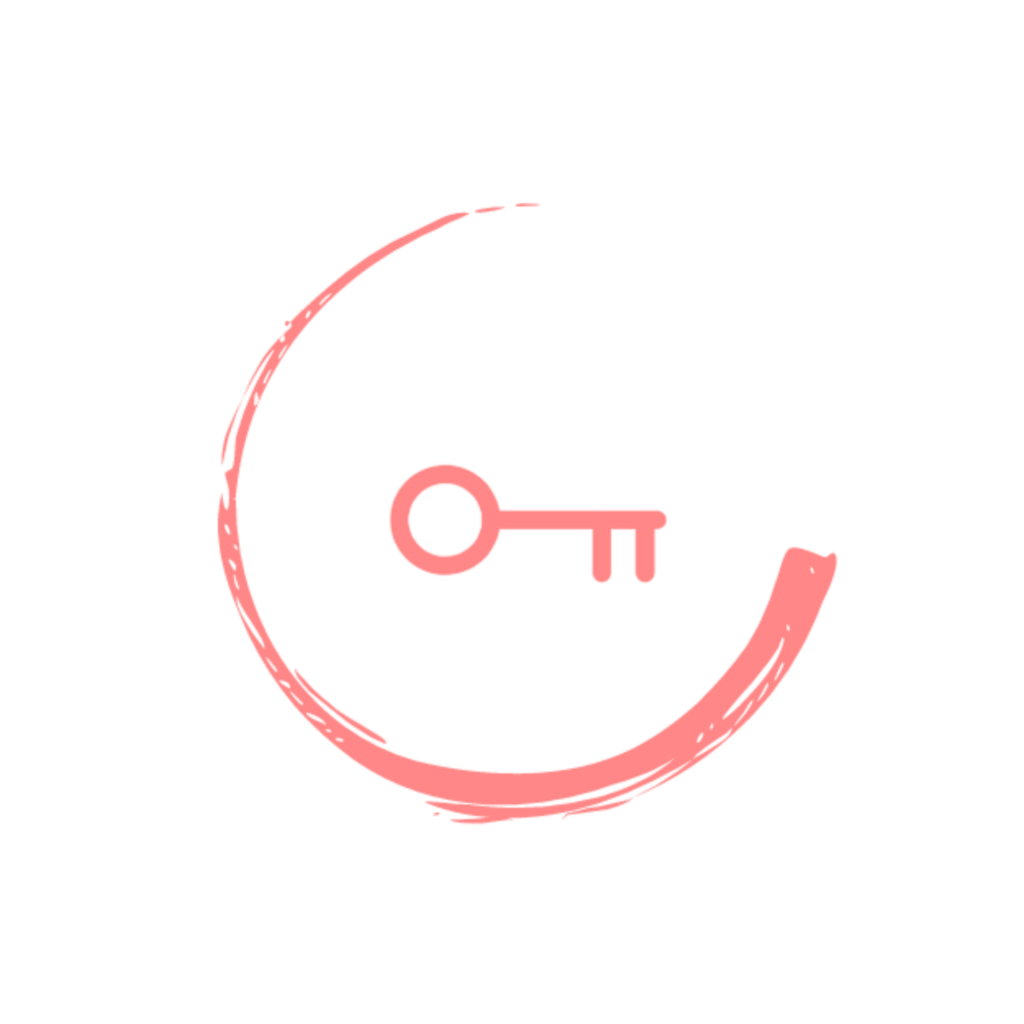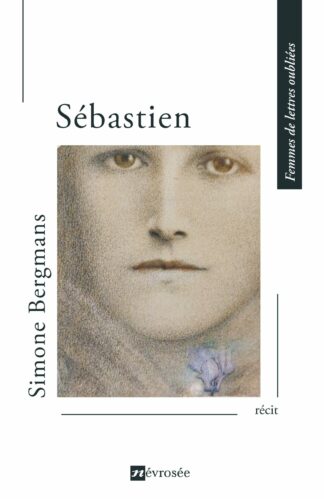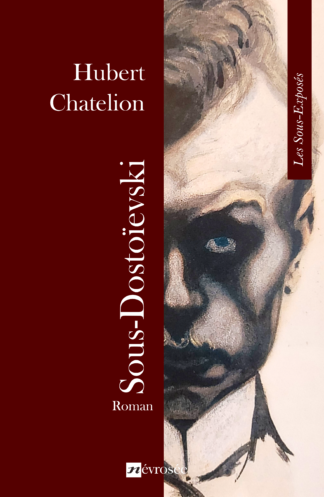I
Je ne sais plus si c’est de confidences ou finalement du rêve seul que ressort mon plus ancien souvenir du musée de Lucera. Peut-être en arriverai-je un jour à mettre en doute son existence même, à la nier avec la même obsession que celle qui aujourd’hui me tenaille et me pousse à parler, comme une aberration parfaite, planant aux frontières de la spéculation et de l’imaginaire.
Une brèche, ou plutôt une profonde coupure qui bientôt se referme et se cicatrise plus ou moins vite, selon les épidermes, mais y laissant à jamais une trace indélébile, voilà comment sans doute définir la visite du musée.
Une sorte de forteresse, dont les parties les plus anciennes, telles que les puissants contreforts des sept tours ancrées dans le rocher, remontent sans doute au moyen-âge, les plus récentes au dix-huitième siècle. Elle domine de loin, isolée au sommet d’une colline dénudée, les quelques maisons aux tuiles rondes d’un village à demi abandonné, dans un paysage qui rappelle certains lieux de Haute Provence, terre caillouteuse, ocrée : oliviers lointains, champs de lavande desséchés, quelques pins noirs et nets sur le ciel d’un bleu intense.
Un chemin part des dernières maisons du village, serpente sur le flanc de la colline, et aboutit à une esplanade en terre battue qui s’étend devant l’entrée curieusement monumentale de la forteresse : une grande voûte à bossages, sous laquelle s’étire un bassin d’eau courante jusqu’à une petite vanne par où s’échappe l’eau, en un ruisselet s’écoulant en contrebas du chemin.
Un enfant joue au bord du filet d’eau : il est accroupi devant son bateau fait d’une planchette et d’un mât rudimentaire qui porte un bout d’étoffe rouge. Il le pousse, déloge et jette un caillou qui empêche sa progression. Il est à bord de son bateau, capitaine solitaire, parti à la découverte d’une île inconnue. Le soleil brille sur la mer, le chant des cigales est celui des sirènes. Antoine se redresse et regarde au loin, vers la colline couverte d’oliviers au-delà du village. Il la peuple de singes et d’oiseaux éblouissants.
Mais il voit une silhouette apparaître à un détour du chemin : une femme élancée, vêtue d’une ample robe blanche et d’un large chapeau également blanc. Elle tient un sac de toile à bout de bras et marche lentement, quoique à longues enjambées.
C’est ainsi qu’apparut Léa à Antoine, et que Léa se souvient d’Antoine, soudain immobile au bord du ruisselet, la fixant, son bateau à nouveau en panne. Léa transpire, il fait déjà chaud et la montée vers la forteresse est ardue. Elle porte un long collier métallique qui fait plusieurs fois le tour de son cou et tinte à chacun de ses mouvements, et de larges lunettes noires. Elles cachent ses rides naissantes, particulièrement nettes autour de ses yeux, mais cependant dès son approche Antoine a jugé qu’elle était vieille, de cette vieillesse sans âge qui pour les enfants commence à trente ans.
Quand je vis Léa pour la première fois, chez des amis communs, je fus frappé par son regard qui, dans un visage aux traits également marqués par les peines et les joies, paraissait doué d’une éternelle jeunesse qui lui avait permis de connaître les unes et les autres avec un égal appétit de la vie, dans toutes ses surprises. Son rire étincelait comme si elle eût quinze ans, elle jouait de ses longs cheveux blonds sur ses épaules avec une grâce voluptueusement assurée.
Chère Léa ! Le souvenir du musée la faisait précisément rire en renversant la tête en arrière, les yeux plissés sur d’incommunicables pensées, que je tentais de débusquer par de pressantes et maladroites questions. Elle m’en avait parlé incidemment, alors que j’évoquais une journée passée à chercher le sens d’un rêve qui m’avait projeté dans l’éveil, soudain démuni de toute approche rationnelle de ma vie. Tandis que je lui en racontais les fuligineuses péripéties, Léa prit la parole à un moment sans doute où la mienne hésitait, et comme « au bond », enchaîna mon discours à la relation de sa visite du musée de Lucera.
Nous avions bu et, sur la terrasse éclairée de quelques torchères, dans la nuit reculée au-delà des frondaisons, la conversation se tissait sur un canevas relâché, au gré duquel chacun avait à dire un mot léger mais chargé de résonances. Entretemps notre hôte était allé chercher un guide touristique de la région décrite par Léa. Le musée de Lucera y était mentionné dans les termes suivants : « Ouvrage au curieux plan heptagonal, du XIIIe au XVIIIe siècle, et dont la tour principale est bâtie sur une source. Un musée y a été aménagé par son dernier propriétaire. À côté de très belles pièces relevant plus des sciences et des techniques que de l’art (instruments d’astronomie, de chronométrie, d’optique) plusieurs salles présentent un amoncellement d’objets divers, de surprenantes constructions mécaniques sorties d’un cerveau pétri d’un scientisme confus, dans un désordre qui a vite fait de décourager le visiteur sérieux ».
À cet adjectif le rire perlé de Léa s’égrena soudain, interrompant la lecture de notre ami, nous empêchant de savoir s’il clôturait ou non la description du guide. Pour elle, manifestement, il marquait un point final :
— C’est incroyable ! Qu’est-ce qu’un visiteur sérieux ?
— Défense de rire devant les objets exposés, hasarda quelqu’un.
— D’ailleurs, ce sont les musées qui sont trop sérieux, dit une dame, je ne trouve rien de plus ennuyeux qu’un musée.
Elle avait une robe à fleurs dans le style des tapisseries délavées des petits hôtels de province. Un parfait musée de l’ennui, pensai-je, en cherchant son mari du regard, un monsieur qui, concentré sur son cigare, digérait, affalé dans un profond fauteuil.
Léa avait eu la même quête du regard que moi, nous nous en aperçûmes en même temps. Et, tandis que la conversation dérivait vers un autre sujet — l’ennui général de la vie -— je m’approchai d’elle.
— Je suis arrivée là par hasard. C’est l’aubergiste du village qui me signala l’existence du musée. J’avais bien sûr vu la forteresse — elle dominait tout le pays — il me dit que je ne regretterais pas la visite. Il devait être un peu le rabatteur du musée…
De quel hasard s’agissait-il ? Elle m’opposa une nouvelle tirade de son rire à une question à ce sujet que je formulai avec précision.
— Que vous importe ? Je cherchais autre chose, j’étais libre — et je compris : je le suis toujours — je flânais d’un arrêt de car à l’autre… Si j’avais été étudiante, je serais peut-être arrivée là à vélo…
Elle plissa les yeux, rêva un instant :
— Il y avait d’ailleurs des étudiants dans notre groupe… et repartit de plus belle dans son rire qui semblait suivre la courbe précise de son souvenir, selon une ponctuation que renforçait, plutôt qu’elle ne la troublait, sa légère ivresse qu’aussitôt j’entretins en remplissant son verre vide.
Était-ce le mot de groupe qu’elle venait d’employer, toujours est-il que j’entrevis pour la première fois mais sans en soupçonner la portée réelle, un élément typique de l’approche du musée de Lucera : le fait, en soi banal, qu’à leur isolement et leurs individualismes initiaux, se substitua peut-être petit à petit une conscience collective de la visite et des événements que celle-ci leur fit subir ou affronter. Mais j’anticipe, et ce fait ne m’apparaissait encore que confusément, en filigrane imprécis derrière le rire de Léa, que je finis par ressentir comme prodigieusement énervant.
— Je partis après le petit déjeuner. Je ne me doutais pas que je retrouverais au musée la majorité des personnes qui avaient comme moi passé la nuit à l’auberge…
Antoine observe Léa qui s’approche de lui, souriante.
— Bonjour, dit-elle. Elle est tout près de lui, il sent son parfum de la ville.
— Le musée est ouvert ? Elle balance son sac, lui sourit à nouveau. Antoine n’a pas répondu.
— Tu es seul ?
— C’est moi le gardien, répondit-il en se retournant vers la forteresse. Sur le mur, à côté de l’entrée, il y a un écriteau de bois qui porte en lettres noires, malhabilement peintes en caractères gothiques, le mot « musée ». Léa l’examine, comme si elle cherchait à y lire les heures d’ouverture. Antoine se dirige vers l’entrée, un couloir qui s’ouvre parallèlement à la voûte sous laquelle se trouve le bassin, et qui conduit droit à la cour intérieure. Il pénètre dans une petite loge sur le côté, dont il ouvre le guichet en rabattant vers l’extérieur le panneau qui le ferme. Il y dispose un rouleau de tickets, quelques cartes postales, une petite boîte en carton.
— C’est ouvert, crie-t-il. Sa tête apparaît dans le guichet, cheveux ébouriffés, yeux noirs et vifs.
Deux autres visiteurs sont entretemps arrivés, une jeune femme en pantalon jaune et un homme muni de tout un attirail de photographie. Ils se tiennent par la main ; Léa reconnaît le couple de jeunes mariés qui séjourne à l’auberge. Elle s’approche d’eux. « Le musée est ouvert », dit-elle à son tour pour relayer Antoine qui n’a pas bougé, attendant que les visiteurs s’approchent de son guichet.
Enlevant d’un geste gracieux ses lunettes noires qu’elle range dans son sac, elle ajoute : « Je vois que notre aubergiste vous a également fait l’article… » Elle rit et dit brusquement en prenant la main de la jeune femme : « Appelez-moi Léa ». Surprise par cette familiarité à la fois abrupte et enjouée, la jeune femme balbutie « bonjour madame et rougit violemment.
Antoine penche la tête hors du guichet. Léa lui adresse un geste : « Nous voici », et s’approche en balançant son sac. Comme s’il jouait à « magasin », Antoine délivre trois tickets, encaisse la monnaie qu’il fait tinter dans la boîte en carton avec une secrète jouissance qui se devine dans la précision redondante de son geste.
Arrivent alors les deux sœurs, vêtues de pantalons délavés et de chemisettes blanches sur lesquelles sont brodés leurs noms : Grete et Margarete. Elles sont essoufflées comme si elles avaient couru, l’une blonde et l’autre rousse. Antoine quitte sa loge et emmène ses premiers visiteurs dans la cour de la forteresse. Un homme grisonnant s’est joint à eux, portant lunettes à fine monture d’acier et vêtu d’un costume d’alpaga froissé ; Léa reconnaît également un pensionnaire de l’auberge.
— C’est l’heure de la visite, proclame Antoine après un coup d’œil purement ludique vers l’horloge dépourvue d’aiguilles de la tour qui fait face à l’entrée, et au pied de laquelle pénètre, par une ouverture basse et large, le bassin qui traverse la cour de part en part. Un petit pont plat l’enjambe, qu’Antoine franchit, se dirigeant vers une colonnade de marbre blanc veiné de rose qui borde la cour sur un côté, teintes que l’on retrouve dans l’appareillage de mosaïque qui recouvre la partie non usée par le temps de la façade intérieure. D’un petit geste péremptoire il indique aux visiteurs l’endroit où ils doivent se placer, face à la cour, sous la galerie. Ils obéissent sagement, l’homme grisonnant s’éponge le front de son mouchoir en regardant Antoine avec un air un peu incrédule.
— C’est toi le guide ?
— Oui. Il ajoute : Je m’appelle Antoine. Et après un instant d’hésitation, avec un geste vague qui semble indiquer un endroit lointain, au-delà des murs :
— Mon père est dans les champs. Et comme pour effacer aussitôt cette référence parentale qui pourrait diminuer sa propre importance aux yeux de ses hôtes, il enchaîne directement en se tournant vers la cour :
— Nous sommes dans la cour du château qui a été construit il y a très longtemps par un seigneur très riche et très bon pour résister à l’attaque des ennemis qui venaient de l’autre côté de la mer il avait construit un château trop grand pour lui pour pouvoir abriter pendant les guerres les paysans qui vivaient tout autour dans la campagne alors ils lui donnaient du blé et du vin qu’ils cultivaient dans leurs champs et dans leurs vignes il y a eu comme ça plusieurs seigneurs qui se mariaient avec les princesses des autres châteaux ils s’amusaient avec des grandes fêtes ils mangeaient des festins formidables ils partaient à la chasse avec leurs chiens féroces ils se bataillaient aussi avec leurs ennemis et faisaient des belles légendes qu’on raconte encore dans les livres… Antoine s’interrompt, essoufflé, les yeux brillants, puis repart avec de grands gestes : Et alors il y a eu un terrible accident le ciel tout noir avec de terribles éclairs est tombé sur le château partout dans la campagne les animaux sont morts et les gens ont oublié de s’aimer les vaches crevaient il n’y avait plus de lait pour les enfants toutes les maisons étaient démolies le château était vide tout le monde finalement était mort ou était parti c’était très triste…
Et c’est fini aussi pour Antoine qui réalise sans transition qu’il vient d’exprimer d’une traite toute sa science sur l’origine de la forteresse. Ou peut-être est-ce l’arrivée de nouveaux visiteurs qui l’a interrompu : deux jeunes gens en jeans et chemises à carreaux, Carl et François, et un couple parfaitement neutre, dont le rôle tout trouvé serait celui de figurants, ou de la foule anonyme qui assiste au spectacle mais n’est pas conviée à y prendre part.
Antoine revient à l’entrée pour les prendre en charge, répétant minutieusement son rituel, de la délivrance des tickets au discours inaugural, qu’il reprend sans franchir le pont. Le premier groupe en suit une version inaudible mais dont il retrouve le fil à travers les mimiques de l’enfant : Grete fait remarquer combien, au-delà de la confusion de son récit, on saisit parfaitement l’« atmosphère historique du château ». L’homme grisonnant s’esclaffe :
— Permettez-moi, mademoiselle, de préciser que nous sommes tout simplement dans une très imparfaite copie, quoiqu’ancienne, du Castel del Monte construit sur les directives de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen — dans les Pouilles, près de Corato — ajoute-t-il en une incidente à laquelle il veut donner le poids d’une évidence flagrante, copie indigne, d’autant plus qu’elle ne compte que sept tours, singulière aberration, alors que Castel del Monte en comprend bien entendu huit, copie caricaturale dis-je, qu’un obscur ascendant des comtes Varelli qui l’occupa jusqu’au siècle dernier se complut, dans une folie qui n’a pas la grandeur hélas de celle d’un Louis de Bavière, à ériger au mépris, dans l’ignorance plutôt, du génie du bâtisseur inconnu de l’original et qui sut, lui, mêler dans un équilibre parfait l’architecture nordique, la mosaïque italienne et l’appareillage de marbre hérité de l’art byzantin…
— Vous êtes professeur ? demande Grete ingénument.
— En effet, répondit-il, une main sur la poitrine, en s’inclinant légèrement, comme s’il se présentait.
Quel vieux con, pense Léa.
Léa : sa main fine tenait son verre vide légèrement penché ; les conversations autour de nous s’étaient éloignées à mesure que la nôtre s’approfondissait et nous rapprochait. Puis nous étions arrivés à une plage de silence sur laquelle nous avancions avec le sentiment que nous allions céder très bientôt à une exquise réalité : celle de jouir très intensément et très précisément l’un de l’autre, dans le creuset bientôt commun et douillet de notre légère ivresse. Notre hôte, comme jailli de l’ombre d’où il eût surveillé avec attention et bienveillance le degré de plaisir de ses invités, s’approcha de nous :
— Nous n’entendons plus votre rire, chère Léa. Monsieur serait-il un ennuyeux ? Léa le biffa d’un rire étincelant subitement retrouvé, qui me parut du coup doué d’un charme que je n’eusse pas jusqu’alors perçu.
Un serveur surgit, portant un plateau chargé de cafés glacés. Léa déposa son verre et se servit.
— La merveilleuse atmosphère de votre soirée, très cher ami, cet éclairage doré d’entracte de spectacles rares, prédispose aux apartés, dis-je, avec une gaucherie qui n’était pas entièrement feinte. Léa me regarda avec un léger sourire qui exprimait sa connivence amusée et, se tournant vers notre hôte qui se tenait toujours devant nous, à présent parfaitement niais, approuva mes paroles d’un rire renouvelé qui le fit aussitôt s’éloigner sur une pirouette. Elle attendit qu’il rejoignît un autre groupe d’invités pour se lever d’un seul mouvement.
— Partons, dit-elle.
En déposant son verre de café glacé sur la table basse qui nous avait rapprochés plutôt que séparés, ses cheveux roulèrent sur ses épaules. Leur mouvement, à cet instant précis, d’onde glissée et se lovant sur elle-même comme le flux d’eau dans une crique emplie d’algues gracieuses, me plongea soudain dans un état de griserie érotique qui faillit me pousse à y porter aussitôt la main à la recherche de sa nuque, au mépris superbe des invités parsemés dans l’ombre environnante. Mais déjà elle se redressait pour ajouter : « Reconduisez-moi ».
Chez Léa : d’abord un escalier sombre, qui me parut interminable, dans un immeuble du début du siècle peuplé du souvenir de milliers d’ombres furtives, et une inexpugnable odeur de soupe sans cesse mijotée dans la loge du concierge. Puis, la porte de l’appartement refermée, une grotte profonde, dont les parois et les détails se révèlent les uns après les autres, au fur et à mesure que Léa allume les lampes basses du salon, comme autant de lumières dans la nuit d’une campagne inconnue. Elle se débarrasse de son léger manteau et se dirige vers un petit secrétaire recouvert de marqueterie, tandis qu’elle m’invite à m’asseoir. Je prends place dans un divan de cuir noir sans style, face à une table basse et à la cheminée où sont deux chenets à tête de chat, aux yeux formés de billes jaunes. Léa fouille son secrétaire, et vient s’installer près de moi en me glissant une carte postale en main.
Elle représente la forteresse telle qu’on la découvre en montant le chemin : l’esplanade, le bassin qui disparaît sous la voûte, l’étroit portail avec la loge d’Antoine, deux rangées superposées de hautes fenêtres à meneaux et une curieuse frise qui court sous la corniche, et qui à l’examen attentif montre une suite alternée de têtes de chiens et de biches.
-— Quand je choisis cette carte dans la loge d’Antoine dit-elle, elle me troubla par son aspect d’ancienneté étrange, d’une certaine façon indatable. Voyez : l’écriteau est absent, le bassin paraît vide, et ses pierres sont en partie descellées. La carte cependant paraît récente, l’épreuve est nette, quoique grise et sans contrastes. Léa tente de me traduire son trouble comme un dédoublement du même événement à travers deux images différentes, l’une morte mais d’une réalité oppressante représentée par la carte postale, l’autre vivante et actuelle : la vue de l’entrée du château dans son état présent, elle-même y figurant en train d’acheter précisément la carte, mais à quelque distance, comme à mi-chemin entre les deux visions.
— Ne trouvez-vous pas qu’on a l’impression, je ne sais pourquoi, que ce château est encore habité, dis-je, et que l’on croit deviner une présence derrière l’une de ces fenêtres, des yeux invisibles fixant le photographe qui prenait le cliché.
Elle est à présent si près de moi, qu’au-delà du subtil parfum de violette dont elle a dû s’oindre légèrement la nuque et la base délicate de son cou, tous mes sens, débordant mon odorat, arrivent aux frontières de sa profonde odeur de femme, mélange de sable chaud, d’air marin et d’herbes ensoleillées comme celles qui devaient border le chemin montant vers la forteresse. Je n’ose tourner le regard vers elle et reste les yeux perdus sur la carte postale, où se multiplient les silhouettes derrière les fenêtres, comme des mannequins diaphanes, prêts à tomber en impalpable poussière à la première poussée sur une porte, dans leur dos.
Léa me prend la carte de la main. Son geste me tire de mon hébétude et, levant les yeux, j’aperçois sur le manteau de la cheminée et je m’étonne de ne l’avoir pas encore remarquée -— une plaque de métal noir, percée de sept trous dissemblables, et distribués selon un ordre à la fois rigoureux et manifestement caché. J’interroge Léa.
— Vous ne devinez pas ? Du musée de Lucera. C’est une sorte de masque, mais je ne l’ai découvert qu’à la fin de la visite. Au début il y avait, dans la première salle où nous avait introduits Antoine, une statue de lave noire, haute de trois ou quatre mètres, un pied devant l’autre, les bras aux poings fermés le long du corps, avec une tête lisse comme un œuf…