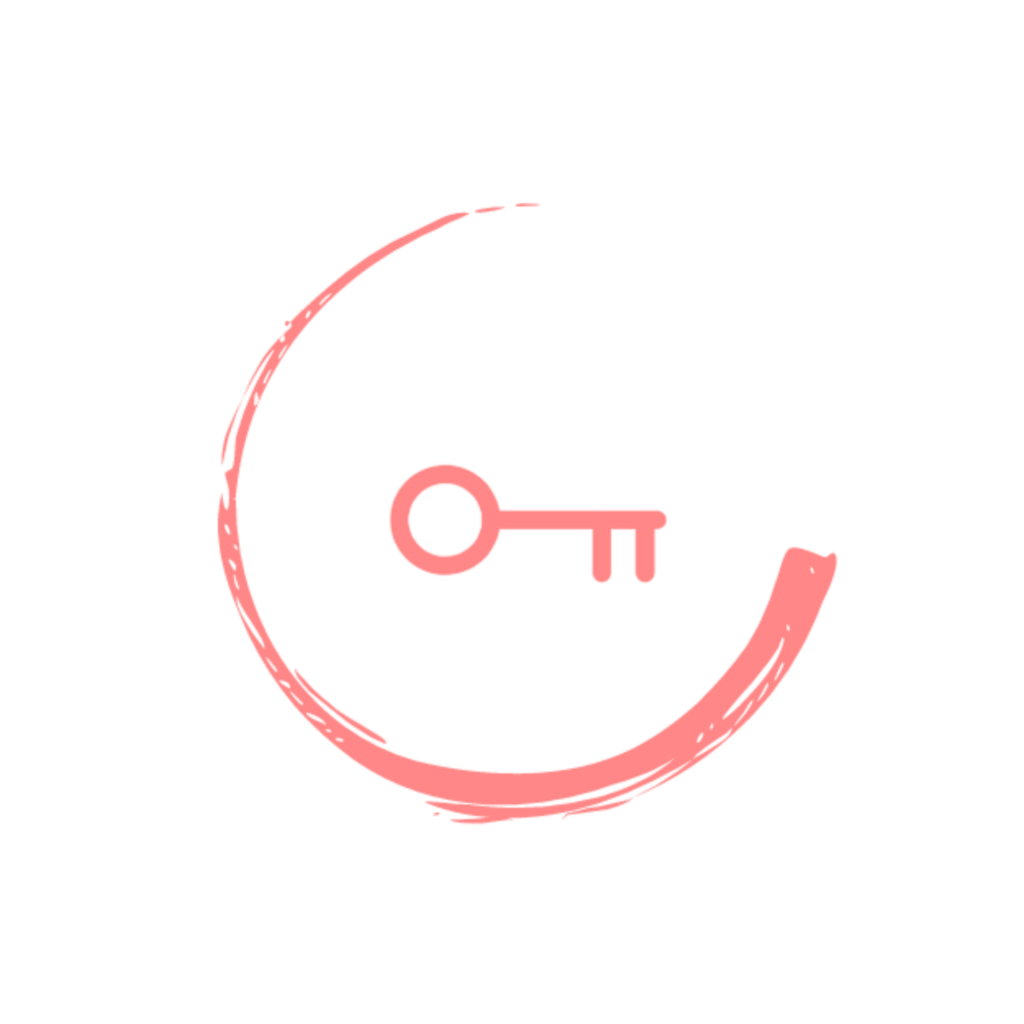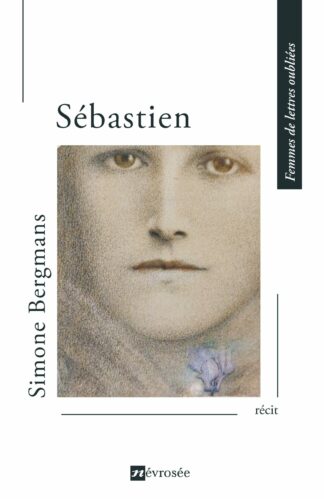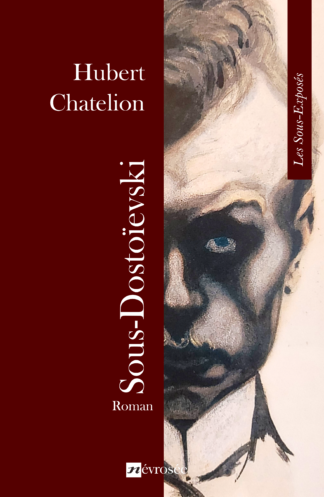I.
Au cours des deux dernières années que Loupoigne dut passer à la faculté de Droit, l’étude lui devint un supplice. Le temps qu’il y consacrait l’arrachait à des songeries qui ne trouvaient plus leur expression dans cette production littéraire de courte haleine qui tente et satisfait les adolescents. Il entrevoyait déjà que sa vie entière serait livrée au tourment qui commençait à le travailler et il désira, de toutes ses forces, acquérir la richesse pour ne pas être astreint au labeur.
Le genre de vie qu’il adopta fut aussi dur pour sa femme que pour lui-même. Elle avait la charge du ménage, ouvrait la porte aux clients. Loupoigme agissait comme sous l’empire d’une idée fixe et la perspective de pouvoir proclamer un jour qu’il était l’artisan de sa fortune ne lui apportait aucun réconfort.
Son train de maison, par trop modeste, lui faisait perdre des clients – même parmi les gens du peuple. Mais c’était surtout auprès de la petite bourgeoisie qu’il se faisait du tort. Lui-même en était issu et, quelquefois, il s’avouait qu’il ne confierait pas volontiers ses affaires à un avocat donnant si fort l’impression d’être avare ou besogneux.
Il n’aimait pas son métier. S’il avait pu choisir sa tâche, il aurait demandé à défendre des prolétaires en lutte contre les pouvoirs établis. Encore n’aurait-il pu se passionner indéfiniment pour ce genre d’occupation.
Il n’aimait pas ses collègues. Loin de lui être sympathiques, les avocats de gauche lui déplaisaient plus que les autres. Exploiteurs à l’égal de leurs confrères réactionnaires, ils vivaient absolument de la même façon. Lui-même, bien qu’il avouât ne travailler que pour s’enrichir, était incapable de réclamer des honoraires qu’on aurait pu juger excessifs. Au barreau, il passait pour un bradeur. Quant à ceux qui profitaient de sa générosité, ils avaient la conviction qu’il était poussé par le souci de se faire une bonne réclame et ils le louaient de savoir s’y prendre habilement.
Loupoigne s’évadait sans effort des misères de sa profession. Il écrivait un vaste roman auquel il travaillait tous les jours, quoique par à-coups, et qu’il méditait sans relâche.
Sa femme suivait passionnément les progrès de son œuvre. Au début, il avait dû lui donner quelques explications, attirer son attention sur certains points de vue. (Comme il devait s’en souvenir, plus tard, pour accroître ses souffrances !) Elle avait compris sans peine et aimait sincèrement presque toute sa production.
De cette entreprise, ils avaient fait le centre de leur existence et ils lui devaient leurs plus belles heures de tendresse et de foi. Au milieu de la nuit, quand l’exaltation de l’amour venait d’apaiser leurs désirs, Loupoigne se levait. Après les tracas et l’agitation d’une journée harassante, rien que le silence de la maison créait une atmosphère irréelle de calme et de rêve. D’une voix vibrante et retenue, il lisait. Et l’émotion qu’engendrait le récit de ces aventures imaginées devenait si grande qu’ils n’entendaient plus les mots.
Au bout de quelques années, le manuscrit avait pris des proportions gigantesques. Hélène, bien qu’inexpérimentée, s’offrit à en tirer un exemplaire définitif.
Tous les soirs, pendant plusieurs heures, elle écrivit à la machine. La fatigue ne tardait pas à se faire sentir. « Il faut que je travaille, se disait-elle alors, en guise d’encouragement. Si cela m’amusait, ce ne serait pas du travail. Que dirait-il s’il se doutait que cette besogne me pèse ? Et puis, cela n’est pas : j’ai sommeil, je suis exténuée. » Elle faisait un dernier effort, mais les fautes s’accumulant comme pour se jouer d’elle, elle abandonnait sa tâche.
Son mari l’épiait, guettant sur son visage l’indice d’une émotion. Il aurait voulu qu’elle fût émue par la moindre intention du texte. Sans doute, il se disait bien qu’après tant de lectures, elle ne pouvait pas être remuée profondément : elle connaissait presque par cœur ce qu’elle recopiait.
De cette vérité attristante, il avait voulu se faire une conviction en relisant plusieurs fois de suite des œuvres célèbres. Il soumit des morceaux de musique à la même épreuve et acquit la certitude qu’on peut se lasser du motif d’une sonate quand on la chante toute une journée. Malgré le résultat de ces expériences, il continuait à épier sa femme, même quand elle s’endormait sur le clavier.
Après un mois d’essai, il fallut renoncer, et Lucienne, la dactylographe, fut mise dans le secret.