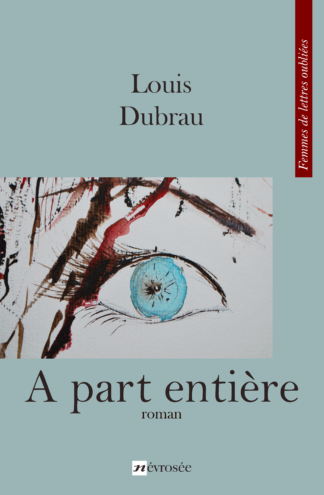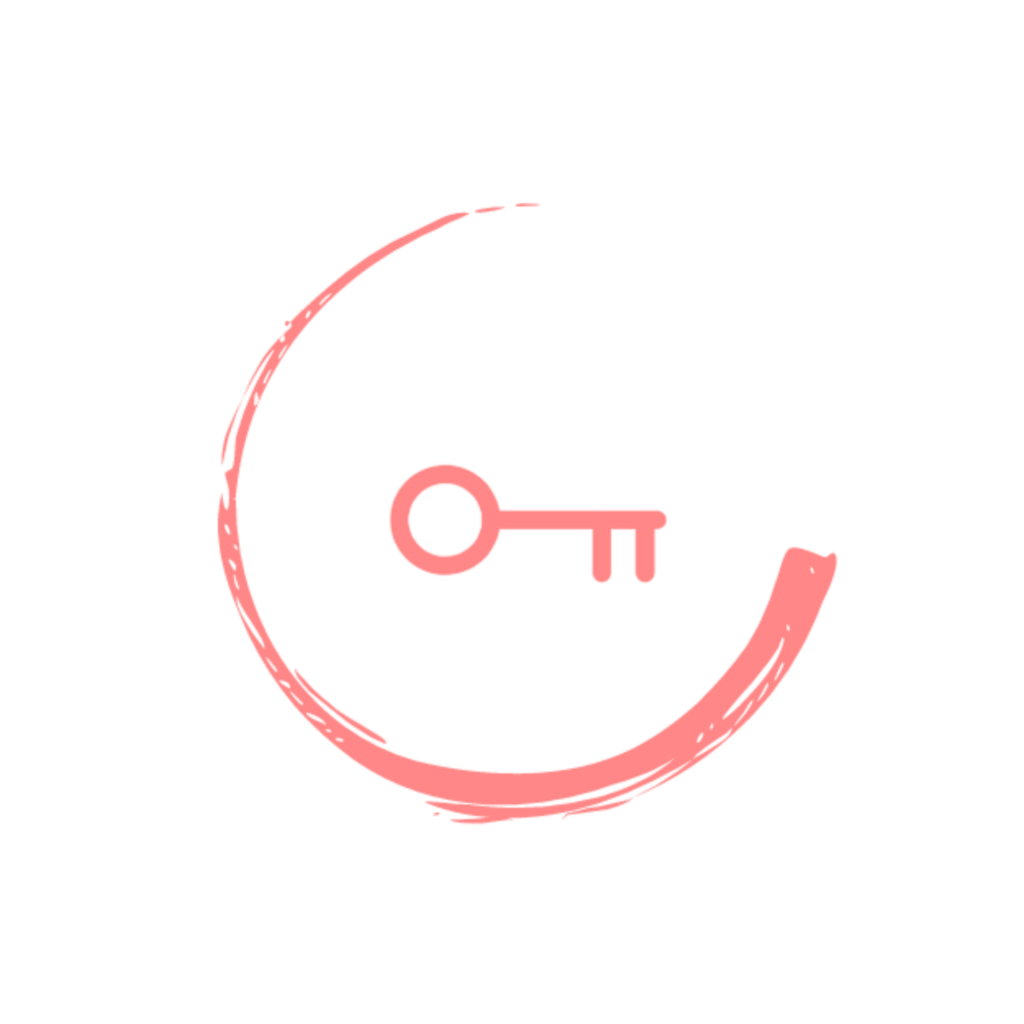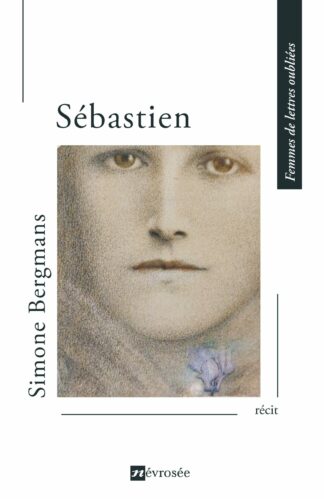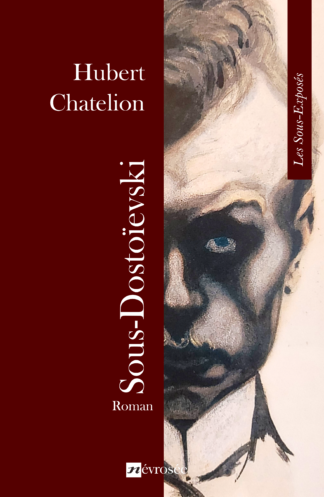I
Ma chère mère,
Privée de tes entretiens, c’est pourtant encore auprès de toi que je me réfugie. Si quelque chose m’étonne ou m’émeut, mon premier mouvement est toujours celui de l’enfant qui s’écrie : « Je vais le dire à ma mère ! » Eh bien ! je te le dirai, malgré l’absence, malgré l’espace ; je te raconterai mes impressions, mes sentiments, sans ordre, sans suite, sans soin. Je me sens mieux déjà depuis que j’ai préparé ce cahier qui t’est adressé, pages blanches sur lesquelles tomberont peut-être des larmes et qui ne seront guère saluées d’un sourire ! En lisant ce mémoire, tu me suivras à la trace dans cette phase difficile de ma destinée.
Cependant, je ne suis mariée que depuis trois mois, et s’il fut jamais un mariage d’amour, c’est le mien. Qui mieux le sait que toi, toi dont je suis la seule enfant, toi que j’ai pourtant quittée pour suivre en pays étranger, en pays inconnu, – en pays ennemi ! – Alphonse Van Zee, que j’aimais tant et qui est aujourd’hui mon mari.
Quitter Paris était pour moi un sacrifice, parce que je t’y laissais ; à tous les autres points de vue, c’était un acte sensé, puisque j’épousais un ingénieur belge. Sa position l’obligeait d’habiter son pays, tout comme ta nationalité et tes habitudes te fixent à Paris.
Et puis, nous nous sommes dit si souvent pour nous consoler : « il n’y a plus de distance ! » C’est possible ; mais il y a et il y aura toujours la séparation.
Tu dois être étonnée de ne pas voir ma lettre datée, comme à l’ordinaire, de l’un ou de l’autre petit village des Ardennes, où nous avions décidé de passer notre lune de miel, moi prenant ma résidence dans quelque champêtre hôtellerie, tandis que mon mari explorait les localités environnantes, afin de lever le plan de son nouveau chemin de fer. Nous nous étions arrangés ainsi jusqu’à présent, quand voilà, tout à coup, mon mari rappelé à Bruxelles. Il s’agit du redressement de tout un quartier. Le genre de travail qui lui incombe nécessite sa présence pendant un certain nombre de mois ; après cela, il aura une mission pour l’Italie. En attendant, au lieu de nous monter une maison pour un temps si court, le parti le plus raisonnable semble être de nous établir chez ma belle-mère, où nous aurons trois pièces au premier étage, plus la jouissance du salon, du piano, la société bruxelloise, la compagnie de mes belles-sœurs et toutes les distractions que comporte cet intérieur. Il va sans dire que nous payons notre table ; la famille n’est pas riche et vit d’une pension de veuve (trois mille cinq cents francs) augmentée d’un revenu de quatre mille francs, plus la propriété de la maison. On nous attendait à bras ouvertes. « C’est pour mieux t’étouffer, mon enfant ! »
Avec quel désordre je t’écris, n’est-ce pas ? L’incohérence même de mes discours peint le trouble de mes sentiments !
Chère mère, t’ai-je dit assez dans quel coin du monde j’ai été la plus heureuse ? Laisse-moi rentrer encore une fois dans ce rayonnement et nommer Herbeumont !
Une solitude sans retouches, telle que la fit la nature, un bijou soustrait aux yeux des touristes, une pensée gazonnée, arborescente, sauvage, un fouillis de rameaux entre lesquels courent une trentaine de maisons faites de grès bleu foncé, d’ardoises, de soliveaux goudronnés et qui, éparpillées parmi les arbres et la verdure, font l’effet d’un troupeau de moutons noirs broutant dans les hautes herbes. Cette pente, c’est le village, c’est même la rue, si l’on veut ; mais c’est toujours la route dans la montagne, c’est le flanc même de la montagne, avec des déchirures, des fondrières, des éboulements, des trouées emplies de mousse et de fougère. Le rocher à pic retient, collé à son granit, comme le nid l’est au tronc, les ruines du vieux château ; les chaînes étagées des hauteurs étalent leurs escarpements cultivés et la vallée de la Semois descend en zigzag. Une vapeur bleue, qui s’élève au-dessus de l’eau et que le plus ardent soleil ne parvient pas à dissiper, dessine en l’air les méandres de la rivière, et, au-dessus de toutes ces choses, qui ne sont que les divers plans de l’Ardenne des hommes, domine, dans toute sa majesté, l’Ardenne de la nature.
L’auberge du Cheval blanc, où j’avais mon campement, est une solitude dans la solitude. Moi qui, pour charmer mes loisirs, avais apporté là de la tapisserie et des romans, j’ai repoussé tout cela avec horreur au fond de ma malle, et sais-tu ce que j’ai fait dans ce pays, aux heures où j’étais seule ? J’ai grimpé jusqu’à l’Ardenne de la nature et là, sans donner aucune formule à mes extases mentales, je me suis couchée dans les hautes herbes, sans paroles, sans pensées, sans avoir besoin de rien au monde, devenue sœur des humbles petites plantes ignorées qui croissaient autour de moi et dont je comprenais l’existence inutile, mais charmante. Aux heures de grand soleil, je dormais peut-être bien un peu à l’ombre des grands sapins bronzés ; l’enchevêtrement de ce groupe d’arbres est tellement touffu, qu’il permet à peine à quelques taches d’or de le percer et de briller sur le gazon ; le rayon de soleil fait l’effet d’un fil, à ce point que l’on tend la main pour l’éloigner ou le saisir : à l’ombre, on a conscience de l’extrême chaleur, sans toutefois la subir. Le rêve ne trouble point cette somnolence ; à travers le sommeil, on perçoit le bruissement de la Semois, et c’est ce bruissement qui empêche de penser, même de rêver, et qui complète le bien-être. On vit pour vivre, à l’exemple de tout ce qui, dans la nature, sent et ne pense pas. Quand mon mari arrivait à ma recherche, nous descendions en nous donnant le bras et nous allions pêcher dans la rivière les truites délicieuses que nous mangions à notre repas du soir.
Je ne te parlerai jamais assez de notre chevauchée dans la forêt qui se trouve au sortir de la vallée d’Autrogne ; c’est là encore une solitude dans la solitude. Par un jour de soleil ardent, on marche pendant quatre heures sous une ombre sans éclaircie, on éprouve un sentiment d’oppression qui arrive à l’effroi d’un tel silence, à la stupéfaction d’une telle tranquillité et qui finit par aboutir à la nostalgie de l’horizon !
Mais me voilà en plein rêve d’Ardennes, tandis qu’en réalité je suis en pleine civilisation, à Bruxelles, chez Mme veuve Van Zee, demeurant rue des Palais, une rue qui ennuie et qui a l’air de s’ennuyer, parce qu’elle est trop large, trop longue, trop raboteuse. Je lui trouve un climat particulier et une température insupportable, probablement parce que je n’y ai jamais été à mon aise, mais que mon sang y a été trop souvent échauffé et mon cœur refroidi. De toute la hauteur de notre lune de miel, de toute la hauteur de nos chères Ardennes, nous tombons dans les bras de Mme Van Zee. Nous venons de l’air libre nous enfermer dans une assez grande maison où demeure ma belle-mère, mais qu’elle n’habite pas. Toute cette famille a des chambres, des robes et des meubles dont elle a peur ; on a immédiatement conscience du suranné, du renfermé et du tempérament de petite ville ; c’est un coin de province au milieu d’une capitale. On nous cède au premier une chambre d’étrangers et un salon dont on n’avait jamais fait usage ; les meubles sont couverts de housses prétentieuses, le lustre est enveloppé d’un sac de gaze ; il y a un tapis sur le tapis, des stores dans les stores, des épingles réunissent les pans des rideaux. Ce qui n’est pas sous housse est sous verre ; pas de poêle dans les belles chambres ; il y a des chaises sur lesquelles on s’assied et des chaises que l’on regarde. L’alignement méthodique du mobilier, les objets qui paraissent usés à force d’être frottés et qui pourtant n’ont pas servi, trahissent la présence d’une vieille fille et, à la lettre, portent son empreinte ; nul traître charbon n’a jamais brûlé dans l’âtre du salon, et l’intérieur de la cheminée est masqué par un carré de soie verte plissée. Le tapis d’escalier se fane depuis des années sous une bonne toile grise, et on ne le verra jamais. Ces gens osent-ils dormir dans leur lit ou s’étendent-ils sur la descente ? La famille se tient au rez-de-chaussée, dans la pièce sur le devant, et les demoiselles ont leur sac à ouvrage marquant leur place à la fenêtre, ainsi que cela se fait en province. Au bout du vestibule, il y a un joli jardin, mais on n’y va jamais parce que l’on n’y voit pas de passants.
Mme Van Zee est effacée par type et par conviction. Est-elle grande ou petite, grasse ou maigre, pâle ou rouge, a-t-elle été jolie ou laide, a-t-elle quarante ou soixante ans ? Je ne sais. Elle étale ses filles et on ne la voit pas. Elle fait ce qu’elle peut pour se charger des années que ses enfants ont de trop ; c’est sans doute pour cela qu’en sa présence, le mot « suranné » vous saute aux yeux, aux narines, à la gorge. Elle est le Dieu dans la machine ; sa main invisible tient le fil où pendent les marionnettes. Elle donne l’idée de ce que serait une illustration de Florian qui aurait séjourné dans l’eau. Elle doit mettre des feuilles de lavande et des oranges vertes dans son linge ; elle a dans un tiroir son portrait en miniature, coiffé avec des anglaises ; elle possède un collier de grenats, une bonbonnière de cristal, héritage de famille que personne n’a cassé depuis un demi-siècle, mais dont personne ne s’est servi, un éventail de satin rose brodé en paillettes, un crêpe de Chine, qui fut son cadeau de noce et qu’elle n’a jamais porté parce qu’elle attendait pour l’exhiber une occasion qui n’est pas venue ; elle a encore sa robe de première communion en mousseline jaunie, avec des entre-deux. Elle porte, l’été, une coiffure de dentelle noire et l’hiver, une frileuse de laine sur une tête plate qui dédaigne tout faux cheveu. Sa grande distraction est le raccommodage des bas : pour cela elle met des lunettes, ayant horreur de tout ce qui rajeunit. Elle ne dit jamais style, sans ajouter épistolaire ; au lieu de français, elle dit fransquillon, et pour désigner une femme d’esprit, elle dit toujours pédante ou bas-bleu.
Mme Van Zee serait bonne si elle n’avait pas trois filles à marier.
Au premier coup d’œil, ses filles me rappelèrent un conte commençant ainsi :
L’aînée avait nom Roussette, la seconde Brunette et la troisième Blondine.
La première est méchante parce qu’elle est rousse.
La seconde est méchante parce qu’elle a vingt-cinq ans.
La troisième est bonne parce qu’elle sera jolie. Mais c’est encore une enfant qui porte des robes courtes ; elle a une poupée, un cerceau et elle va à l’école. Elle a une figure de Keepsake et une chevelure de soie blonde et mate étalée en nappe.
La grande différence d’âge qui existe entre mes belles-sœurs s’explique par la perte de trois autres enfants qui échelonnaient ces distances.
Roussette a une laideur plate et mouchetée de jaune. La nature, prodigue envers elle de défaveurs, lui a octroyé assez de cheveux d’ocre pour garnir convenablement trois têtes. Elle a trente ans ; elle est méchante par âge, par tempérament et par volonté. La méchanceté fait sa consolation et sa gloire. Elle s’amuse à épouvanter les jeunes filles qui font leur entrée dans le monde et leur faire payer cher l’impertinence d’avoir dix-huit ans ; pour cela elle leur demande d’un air sérieux le nom de leur couturière, ajoutant, en riant aux éclats, que c’est afin de n’y point aller ; elle leur apprend que le danseur qui les courtise à leur premier bal est marié ou pour le moins fiancé ; elle s’informe affectueusement de la santé du parent pauvre qui est à l’hospice, de la tante qui tient boutique ou de la cousine qui fit une escapade de jeunesse. Elle est brevetée vieille fille ! C’est écrit dans ses yeux malveillants et injectés de bile ; c’est dans les notes de sa voix de crécelle, dans la forme de sa personne : une charpente qui se plie en divers compartiments, mais qui n’est pas mouvementée ; son esprit a du trait tout en manquant d’idées ; son cœur a du flair et ne connaît pas le sentiment. Elle est réconciliée un peu avec sa personne, depuis les succès de Cora Pearl et avec sa voix, depuis la célébrité de Thérèsa ; car il faut vous dire que ça chante, ça lance des trilles, ça pousse des roulades, ça hurle des airs de grand opéra avec une splendeur de criailleries qui cause aux nerfs des auditeurs la sensation que fait éprouver un bouchon de liège tournant dans le goulot d’une bouteille.
Cette fille a l’audace, mais hélas ! une audace sans piédestal : ni la fortune, ni le talent, ni le vice. Elle doit se borner à des succès très restreints : épouvantail de pensionnaires, croque-mitaine de salons bourgeois et oracle dans la famille. Il n’y a rien de plus amusant que de voir à quel point sa mère et sa sœur craignent de la contrarier. Quand elle prononce une phrase, toujours sentence ou arrêt, la mère approuve en répétant les deux dernières syllabes, et la sœur la dernière ; cet exercice est devenu une manie dont les acteurs ne s’aperçoivent plus, mais qui aux nouveaux venus fait ouvrir de grands yeux. Exemple : Roussette remarque que le mariage de monsieur avec mademoiselle est bête comme deux oisons ; oisons dit la mère, sons redit la sœur. Ce tic est devenu proverbial dans la société qui fréquente la maison.
Brunette a le type flamand ; elle pourrait être jolie, si elle consentait à l’être à la manière des nymphes de Jordaens, avec sa chevelure noire en dehors, rousse en dedans et où un coup de peigne produit des reflets de flamme, ses yeux verts à fleur de tête, ses grosses joues rouge-pivoine, son nez trop court, ses lèvres charnues et charnelles, ses fortes hanches de plébéienne, son cou rond et court qui a un collier naturel de plis de graisse, sa gorge saillante et relevée, son corps grand et robuste dont les formes vigoureusement accusées se modèlent dans l’étoffe du vêtement, qu’elle qu’en soit l’épaisseur. Mais elle ne veut pas de cette beauté-là, elle veut avoir l’air comme il faut ; elle brûlerait des cierges au diable pour être délicate, et toute sa préoccupation est de s’amincir ; le tour de taille coupant cette masse de chair par le milieu, donne envie de crier grâce. Mais il n’y a pas de bottines qui parviennent à lui octroyer l’aristocratie des pieds, ni de gants qui puissent pétrir la lourde pâte de ses mains. Je suis sûre que, le matin, elle se tire le menton pour parvenir à la figure ovale, et le nez afin d’empêcher les regards indiscrets d’apercevoir, par ses narines rondes et évasées, ce qui se passe dans son cerveau ; le pince-nez qu’elle porte a sans doute le même motif. Au lieu d’accommoder son type à la sauce flamande, la conscience qu’elle a de sa vulgarité fait la tourmente de sa vie. Elle doit déjà s’être proposé des femmes du monde pour modèle, car, non contente de se pincer le nez, elle pince aussi son accent et son sourire, et marche à petits pas, ayant toutes les peines du monde à ne pas marquer la cadence par un mouvement naturel des hanches, et à ne pas se laisser aller à d’énormes enjambées. Sa démarche contenue, son geste et son port de tête font penser à un cheval de labour qui se trouverait attelé à un tilbury, au lieu de l’être à sa charrue.
Son double menton provient-il de ce qu’elle est de mauvaise humeur, est-elle de mauvaise humeur parce qu’elle a un double menton, ou se rengorge-t-elle de l’orgueil d’avoir les charmes d’une cuisinière endimanchée et lavée au savon de Marseille ?
Elle a adopté le noir, singerie du bon genre, et le jaune par penchant naturel à la vulgarité, elle a une autre couturière que celle qui habille le reste de la famille et se met tout autrement que sa sœur aînée. On dépense beaucoup d’argent pour sa toilette, car il est décrété que celle-là, on la mariera ; tout l’entourage le veut, même Roussette, qui se rend justice et sait le nombre de ses chevrons. On promène et l’on exhibe Brunette de toutes les manières : elle va au bal et au spectacle, elle s’assied sous les ombrages du parc et fait des évolutions sur la montée que l’on appelle rue de la Madeleine ; Roussette n’est dans la suite de sa cadette qu’une dame du corps de ballet.
Les deux sœurs et la mère ne se ressemblent pas et, cependant, ont un air de famille par cette identité d’expression que contractent les personnes vivant dans la même sphère d’idées et ayant les mêmes habitudes. C’est sans doute pour cette raison, qu’au bout de quelques années de mariage, le mari et la femme ont le même jeu de physionomie et se mirent mutuellement dans leurs rides.